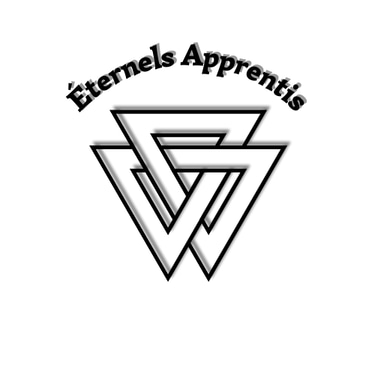Ceci est notre premiere maquette ISSUE DE L'IA ET L'IH.
ameliorons ensemble ce projet, grace a notre intelligence collective et nos reseaux sociaux.
Ce site est une base de travail.
Complots ou potes cons ? La solution proposée par le média des Eternels Apprentis
46 min read
I. Le mot “complotisme” : un concept instable, mais utile
II. Peut-on enquêter sans être complotiste ?
III. Faut-il donner la parole aux complotistes ?
IV. Méthodes institutionnelles et scientifiques de réponse au complotisme
V. Limites et résistances du fact-checking journalistique
VI. La démocratie comme cadre de la recherche critique
VII. Une méthode possible : enquête collective, assistée par outils neutres et orientée par des humains
Dans le vocabulaire contemporain, peu de termes suscitent autant d’ambiguïtés sémantiques et de tensions politiques que celui de complotisme. Largement diffusé depuis le début des années 2000, notamment à la suite des attentats du 11 septembre 2001, il tend à désigner des formes d’explication du monde fondées sur l’idée de manœuvres secrètes orchestrées par des groupes d’intérêts dissimulés.
Le mot est pourtant instable. Il oscille entre une désignation descriptive – celle d’un mode particulier de raisonnement – et une fonction disqualifiante dans le débat public. On l’emploie pour stigmatiser un adversaire, parfois simplement critique, parfois effectivement engagé dans des logiques de déni, de soupçon généralisé ou de rejet de l’expertise. Il n’existe pas, en ce sens, de définition univoque du complotisme : les chercheurs eux-mêmes s’accordent sur le fait qu’il constitue un objet flou, évolutif, polymorphe (Taguieff, 2005 ; Bronner, 2013 ; Huyghe, 2016).
L’usage courant tend à amalgamer deux postures distinctes : celle du questionnement méthodique, inscrit dans une logique d’enquête rationnelle, et celle d’une suspicion généralisée, motivée par une méfiance structurelle envers toute forme d’autorité ou d’explication institutionnelle. L’enjeu n’est donc pas tant de condamner ou de défendre l’attitude dite “complotiste”, que d’en interroger la structure, les seuils de bascule, et les critères distinctifs.
Dans cette perspective, ce travail s’efforce de clarifier plusieurs points :
Ce que recouvre historiquement et conceptuellement le terme de “complotisme” dans les travaux des politologues, des sociologues de la connaissance et des philosophes des sciences ;
La distinction méthodologique entre une démarche critique fondée sur le doute rationnel (au sens cartésien ou poppérien du terme) et les formes de pensée infalsifiables propres aux théories du complot ;
Les conditions d’un dialogue épistémique légitime avec des discours complotistes, y compris dans leurs formes argumentées ou documentées ;
Les possibilités offertes par une méthode d’enquête collective et documentée, notamment à travers l’usage d’outils d’assistance cognitive comme l’intelligence artificielle, dans une logique d’objectivation et de transparence.
Il s’agira, non pas de trancher entre ce qui relèverait du “vrai” ou du “faux” dans l’absolu, mais de proposer une manière de penser les conditions dans lesquelles une hypothèse gagne ou perd en plausibilité, au regard des méthodes de vérification disponibles.
Car toute remise en question d’un récit dominant n’est pas suspecte par nature. Mais toute hypothèse alternative ne vaut pas, de ce seul fait, comme explication recevable. Entre la crédulité naïve et le scepticisme radical, il existe une voie médiane : celle de l’examen, du débat argumenté, et de la rigueur méthodologique. C’est à cette voie que cet article souhaite contribuer.
I. Le mot “complotisme” : un concept instable, mais utile
A. Définitions académiques du complotisme
Si le mot “complotisme” est aujourd’hui couramment utilisé dans les médias, la recherche en sciences sociales et en philosophie en propose des définitions plus précises, bien qu’hétérogènes. Il ne s’agit pas seulement de croire qu’un complot a eu lieu — ce qui peut être historiquement avéré — mais d’adopter une certaine forme de raisonnement explicatif, fondée sur des présupposés spécifiques.
L’un des premiers à proposer une définition théorique du phénomène est le philosophe Karl Popper, dans Conjectures et Réfutations (1963). Il y décrit ce qu’il appelle “la théorie conspirationniste de la société” comme l’idée selon laquelle “tout ce qui se passe dans la société – y compris ce qui est généralement perçu comme indésirable – est le résultat direct du dessein de quelques individus ou groupes puissants.” Il s’agit, pour Popper, d’une forme de pensée pré-scientifique, assimilable à une survivance du mythos dans le logos moderne.
“Au lieu de croire aux dieux de l’Olympe, les hommes croient aujourd’hui à des groupes puissants qui tirent les ficelles.”
— K. Popper, Conjectures et Réfutations, 1963
Dans un cadre plus sociologique, Pierre-André Taguieff a joué un rôle fondamental dans la conceptualisation du “complotisme” comme style de pensée. Il définit la théorie du complot comme un “récit globalisant, fondé sur une intentionnalité cachée, mettant en scène une minorité agissante, dotée d’une volonté mauvaise, et agissant en secret pour dominer ou nuire” (La Foire aux illuminés, 2005). Il y identifie deux composantes essentielles :
Une rhétorique du dévoilement (le complotiste se présente comme celui qui “voit ce que l’on cache”),
Une rhétorique de la dénonciation morale (les conspirateurs sont nécessairement diaboliques, le complotiste, du côté des “justes”).
Du côté des sciences cognitives, Gérald Bronner propose, dans La Démocratie des crédules (2013), une approche complémentaire : le complotisme serait moins un contenu qu’un effet de disposition cognitive dans un environnement d’information dérégulé. Pour lui, la croyance dans les théories du complot s’explique par l’interaction entre :
des biais cognitifs universels (biais d’intentionnalité, de confirmation, illusion de corrélation),
la structure de l’espace public numérique, qui favorise la visibilité des récits engageants, au détriment de la robustesse des preuves.
Enfin, dans une perspective politique et épistémologique, Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch, insiste sur le caractère non falsifiable des discours complotistes : “Toute donnée contraire à la théorie est aussitôt interprétée comme une preuve de plus que le complot est bien réel – puisqu’on cherche à le cacher” (L’Opium des imbéciles, 2019). Le complotisme, selon lui, n’est pas seulement une erreur de jugement : c’est un mode de pensée autoréférentiel, dont la cohérence interne s’accommode mal du débat contradictoire.
I.B. Un terme aux usages multiples : entre typologie analytique et étiquette polémique
Si la littérature académique s’efforce de cerner avec précision les caractéristiques propres à la pensée complotiste, l’usage courant du terme “complotisme” s’écarte souvent de cette rigueur. Il tend à fonctionner comme une catégorie rhétorique glissante, mobilisée dans le débat public pour disqualifier une position sans l’examiner sur le fond. Cette fonction dissuasive a conduit certains chercheurs à interroger les effets pervers d’un usage indiscriminé du terme.
1. Un mot disqualifiant plutôt que descriptif
Le terme “complotiste” est fréquemment employé en amont de tout argument, comme une insulte épistémique (Fricker, 2007) : son invocation suffit à rendre suspect un discours, quel qu’il soit, dès lors qu’il remet en question une version dominante. Cette dynamique produit un effet de clôture du débat : en désignant l’autre comme irrationnel ou paranoïaque, on s’exonère de toute réfutation argumentée.
“Le terme ‘complotiste’ devient souvent une manière de rejeter d’un bloc la critique, sans en discuter la pertinence ou les fondements.”
— Didier Fassin, anthropologue, Collège de France, 2020
Certains auteurs et intellectuels critiques, pourtant éloignés de tout conspirationnisme, ont eux-mêmes été qualifiés de “complotistes” dans le débat médiatique : Noam Chomsky, pour ses analyses de la politique étrangère américaine ; Michel Collon, pour ses critiques de l’OTAN ; Slavoj Žižek, pour sa remise en cause des récits dominants. L’usage extensif du terme devient alors contre-productif : il jette le discrédit sur toute forme de dissidence ou de contre-enquête, même rigoureuse.
2. La critique du “complotisme” comme outil de contrôle symbolique
Dans un article remarqué publié en 2018, le politologue Mathieu Rigouste évoque le risque que la lutte contre le complotisme serve d’écran idéologique, permettant de neutraliser toute remise en question du pouvoir. L’accusation de complotisme peut être, dans certains cas, instrumentalisée par les institutions pour écarter des opposants politiques. La dénonciation de “fake news”, bien que nécessaire, peut aussi masquer une rhétorique d’autorité – où la vérité serait simplement ce que dit l’institution.
L’UNESCO elle-même, dans son guide Thinking critically about conspiracy theories (2022), reconnaît qu’il est impératif de distinguer entre la remise en question légitime d’un discours dominant et l’adhésion à une théorie conspirationniste fermée. Le guide insiste sur la nécessité de ne pas assimiler toute critique des autorités ou des médias à du complotisme, au risque d’entretenir un climat de méfiance accru.
3. Nécessité d’un usage discriminant
À l’inverse, nier le caractère problématique de certaines affirmations au prétexte de “l’ouverture d’esprit” peut conduire à normaliser des récits infondés ou dangereux. D’où la nécessité d’un critère de distinction clair, non moral mais épistémologique :
Une critique légitime se fonde sur l’examen méthodique des sources, accepte la contradiction, et admet ses limites.
Une théorie complotiste, au sens initial, repose sur un récit clos, non réfutable, saturé d’intentionnalité, et souvent peu documenté.
“Il ne s’agit pas de tracer une frontière idéologique entre le vrai et le faux, mais une distinction méthodologique entre ce qui s’expose à la réfutation et ce qui s’en protège par principe.”
— Karl Popper, repris par Bronner (2013)
En résumé
Le terme “complotisme” ne doit pas être manié comme un instrument polémique servant à exclure des voix critiques du champ du dicible. Il convient de l’employer avec précision, en s’appuyant sur des critères rationnels. Mal utilisé, il affaiblit la capacité du débat démocratique à intégrer des objections. Bien défini, il permet de penser les limites du soupçon et les dérives du discours infalsifiable.
C. Distinguer la pensée critique du complotisme radical
Après avoir clarifié les définitions savantes du complotisme (I.A) et les dérives de son usage polémique (I.B), il devient nécessaire de proposer des critères opérationnels permettant de distinguer ce qui relève d’un discours conspirationniste structuré d’une interrogation critique légitime.
Autrement dit, à partir de quand une hypothèse controversée, un doute méthodique ou une contestation d’un récit dominant cesse de participer à la recherche rationnelle pour entrer dans une logique de complotisme au sens fort ?
La recherche contemporaine en épistémologie sociale et en sociologie des croyances propose plusieurs critères cumulatifs, largement partagés par les spécialistes du sujet.
1. Infalsifiabilité : le refus de tout désaveu possible
C’est un point central dans la tradition philosophique depuis Karl Popper : une hypothèse devient problématique non par son contenu, mais parce qu’elle est formulée de manière à ne jamais pouvoir être réfutée.
Un exemple-type de raisonnement infalsifiable :
« Si la version officielle nie le complot, c’est parce qu’elle fait partie du complot. »
Ce bouclement épistémique empêche toute discussion sérieuse. Il rend le récit autonome par rapport aux preuves, voire résistant à toute falsification empirique. Gérald Bronner appelle cela un “cercle de croyance autosuffisant” (Bronner, La Démocratie des crédules, 2013).
2. Récit saturé d’intentionnalité
Dans les discours complotistes, les événements sont rarement analysés comme le fruit de conjonctions de facteurs (erreurs, systèmes, chaos, interactions non planifiées). Ils sont interprétés comme volontairement provoqués par un ou plusieurs agents dissimulés, dont les intentions seraient à la fois malveillantes et omnipotentes.
“Le hasard est exclu. La bêtise est exclue. L’accident est exclu. Reste : le plan.”
— Pierre-André Taguieff, La Foire aux illuminés, 2005
Cela entraîne un réductionnisme causal : la complexité du réel est rabattue sur une logique unique d’explication par la volonté secrète.
3. Manichéisme structurel
Le monde est divisé en deux camps clairs :
Les manipulateurs puissants, souvent inhumains, impersonnels ou démonisés (les élites, les banques, “le système”, etc.)
Les éveillés, “lucides”, “hors de la matrice”, souvent auto-désignés comme résistants à la propagande
Ce schéma binaire, que Taguieff décrit comme “soteriologique” (visant le salut), est affectivement structurant : il valorise le croyant, le distingue du “troupeau”, le protège du doute.
4. Sélectivité de l’information et hyperlecture
Les discours conspirationnistes mobilisent parfois des fragments de réel, des documents authentiques ou des témoignages partiels. Mais ils les organisent selon un biais de confirmation : ne sont retenus que les éléments qui confortent l’hypothèse de départ.
Cette sélectivité interprétative peut s’accompagner d’une surinterprétation des signes : ce que les historiens appellent l’apophénie (perception de relations significatives dans le hasard). Un détail devient une preuve, un lapsus devient un indice, un symbole devient un message caché.
5. Rejet global des médiations institutionnelles
La pensée complotiste contemporaine s’accompagne souvent d’une défiance systématique vis-à-vis de toutes les formes d’expertise institutionnelle : science, presse, justice, médecine, université. Les “preuves officielles” sont vues comme suspectes a priori, ce qui conduit à une forme de désintermédiation radicale du savoir.
“Ils n’ont plus besoin d’autorité, parce qu’ils se vivent comme leur propre autorité. Le complotiste devient son propre ministère de la vérité.”
— Gérald Bronner, conférence au Collège de France, 2021
Cela ne signifie pas que la critique des institutions soit impossible — mais qu’ici, elle devient totale, homogène, non différenciée, et ne laisse plus d’espace à la contradiction.
II. Peut-on enquêter sans être complotiste ?
A. Le doute comme fondement méthodologique de la pensée critique
L’un des problèmes récurrents dans le débat public contemporain est la confusion entre mise en doute et complotisme. Il est alors crucial, sur le plan épistémologique, de restaurer la légitimité du doute rationnel comme outil d’examen intellectuel, distinct du soupçon systématique propre à la pensée conspirationniste. Le doute n’est pas en soi un signe de dérive ; au contraire, il constitue le point de départ de toute démarche de connaissance rigoureuse.
1. Le doute méthodique chez Descartes : une suspension provisoire du jugement
Dans les Méditations métaphysiques (1641), René Descartes expose le principe du doute méthodique : il s’agit de suspendre temporairement l’adhésion à toutes les croyances afin d’examiner lesquelles résistent à l’épreuve de la raison. Ce doute est provisoire, raisonné et orienté vers la vérité. Il ne vise pas à affirmer que tout est mensonge, mais à fonder un savoir certain en éliminant les sources d’erreur.
« Je ne veux pas pour cela imiter les sceptiques, qui doutent seulement pour douter et affectent d’être toujours irrésolus. »
— Descartes, Méditation I
Cette précision est fondamentale. Le doute cartésien ne nie pas la vérité, il cherche à la consolider par un examen exigeant. Il se distingue radicalement du doute dogmatique qui affirme que “tout est faux” sans critère méthodique de jugement – une posture souvent présente dans les récits complotistes.
2. Le critère de falsifiabilité chez Karl Popper
Au XXe siècle, Karl Popper prolonge cette exigence dans le champ de la philosophie des sciences. Il définit la rationalité scientifique non par sa certitude, mais par sa capacité à être réfutée. Une théorie est rationnelle si elle est falsifiable, c’est-à-dire si l’on peut concevoir des expériences ou des faits qui, s’ils étaient observés, la rendraient fausse (La logique de la découverte scientifique, 1934).
« Une théorie qui n’est pas réfutable par un événement concevable est non scientifique. »
— Popper, Conjectures et Réfutations, 1963
Cette logique du “risque d’erreur” distingue la connaissance ouverte (modèle de la science) de la croyance close (modèle du complotisme). Remettre en question une explication dominante est donc légitime à condition de proposer une hypothèse testable, exposée à la contradiction, et examinée avec les instruments du raisonnement.
3. Feyerabend et le pluralisme des démarches
On ajoutera la perspective plus radicale de Paul Feyerabend, qui conteste dans Contre la méthode (1975) l’idée d’un “ordre” unique de la science. Il défend un pluralisme méthodologique, affirmant que les véritables avancées scientifiques se sont souvent produites en transgressant les normes établies. Cela ne justifie pas l’arbitraire, mais réhabilite la dissidence méthodique comme moteur de progrès.
« Il n’y a pas de méthode universelle. Ce qui fait la valeur d’une théorie, c’est sa capacité à concurrencer d’autres explications, pas à s’immuniser contre elles. »
— Feyerabend, 1975
Ainsi, poser des questions gênantes, revisiter des enquêtes officielles, ou explorer des angles peu traités ne constitue en rien un signe de dérive – à condition que ces démarches s’inscrivent dans une éthique de la confrontation et non dans une logique d’autovalidation.
B. Peut-on enquêter sur des sujets sensibles sans être disqualifié ?
L’un des enjeux les plus délicats de l’analyse contemporaine du complotisme est de savoir comment enquêter rationnellement sur des événements controversés, souvent associés à des récits conspirationnistes, sans se voir accusé de les relayer. Cette question est d’autant plus cruciale que certains domaines, comme les attentats du 11 septembre, les campagnes vaccinales, ou les conflits géopolitiques majeurs (Israël/Palestine, Ukraine, etc.) sont devenus des terrains saturés de discours polarisés, où toute posture d’investigation semble suspecte.
1. L’enquête critique n’est pas un privilège institutionnel
Le fait qu’un discours soit alternatif, minoritaire, ou extérieur aux canaux dominants ne le rend ni vrai ni faux en soi. Ce qui importe, d’un point de vue épistémologique, n’est pas l’origine du discours, mais sa structure argumentative et ses modalités de vérification. L’histoire des sciences et du journalisme montre que des vérités importantes ont souvent été révélées en dehors des institutions établies : pensons à l’affaire du Watergate (révélée par deux journalistes indépendants), à la réhabilitation de Dreyfus (défendue d’abord par une minorité), ou plus récemment à certaines révélations sur les abus de surveillance (Edward Snowden, etc.).
« Ce qui compte, ce n’est pas de savoir qui parle, mais si ce qui est dit peut être vérifié, discuté, réfuté. »
— Jacques Bouveresse, La connaissance de l’écrivain, 2008
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un sujet est “complotogène” qu’il est interdit de l’examiner. L’investigation sur les attentats du 11 septembre, par exemple, peut donner lieu à :
des relectures techniques des rapports officiels (comme celles produites par des ingénieurs ou des architectes),
des critiques sur la transparence des commissions d’enquête,
des analyses médiatiques sur la couverture initiale des événements.
Ces travaux peuvent être parfaitement rationnels, pourvu qu’ils explicitent leurs hypothèses, mobilisent des données vérifiables, et intègrent la possibilité d’avoir tort.
2. Accueillir l’argumentaire complotiste pour le soumettre à la critique
Refuser d’écouter un raisonnement en raison de son origine soupçonnée (ou de sa “mauvaise réputation”) empêche d’exercer une critique rationnelle. Au contraire, un argument faux ou douteux doit être reçu, reconstruit dans sa meilleure forme (principe de charité), puis examiné point par point.
Par exemple, sur les événements du 11-Septembre, les affirmations suivantes circulent régulièrement :
“Aucune trace d’avion sur le Pentagone”
“Les tours ne peuvent pas s’effondrer de cette manière sans explosif”
“Le passeport retrouvé est une mise en scène”
Ces éléments, même lorsqu’ils s’avèrent faux ou inexacts, méritent une réponse factuelle et documentée. Des travaux comme ceux du Skeptical Inquirer, du NIST (National Institute of Standards and Technology), ou des chercheurs en ingénierie permettent précisément de répondre de manière technique et argumentée à ces affirmations, sans posture moralisatrice.
En réponse, il est tout à fait possible, de façon rationnel, de remettre en cause les modèles de calcul utilisés par le NIST.
« C’est en confrontant les arguments sur leur terrain que l’on permet de montrer la différence entre critique et délire. »
— Élisabeth Badinter, entretien dans Le Monde, 2017
La logique est donc claire : recevoir une critique est différent de valider son contenu. Refuser d’y répondre sous prétexte qu’elle serait “complotiste” par essence produit souvent l’effet inverse : elle se radicalise, se sent légitimée par le silence ou le mépris, et se renforce dans l’entre-soi.
3. Admettre les zones d’incertitude comme une force, non une faiblesse
Une différence majeure entre la posture critique rationnelle et la posture complotiste réside dans le rapport à l’incertitude. Le discours conspirationniste se construit souvent sur des zones floues pour en tirer une certitude de dissimulation. À l’inverse, la démarche critique accepte de dire : “on ne sait pas tout, et cela ne signifie pas que tout est faux”.
En philosophie des sciences, cette attitude est celle du scepticisme modéré (Engel, Bouveresse), qui admet l’incomplétude des explications humaines sans sombrer dans la négation généralisée. Accepter qu’un événement soulève des questions ne légitime pas pour autant n’importe quelle réponse.
« Le doute n’est pas le contraire de la rigueur. C’est son point d’ancrage. »
— Pascal Engel, Les lois de l’esprit, 1990
C. La différence décisive : la méthode
Dans les sections précédentes, nous avons souligné que le contenu d’une hypothèse ne permettait pas, à lui seul, de la qualifier comme complotiste ou non. Une affirmation peut être dérangeante, minoritaire ou iconoclaste sans être déraisonnable. La différence essentielle réside dans la méthode utilisée pour la formuler, la défendre et l’évaluer.
Autrement dit, ce n’est pas ce que l’on croit qui est décisif, mais comment on y croit, pourquoi, et jusqu’où.
1. Une méthode ouverte : hypothèse, vérification, confrontation
La démarche critique rationnelle repose sur un cycle intellectuel structuré :
Poser une hypothèse claire, sans la tenir pour certaine d’emblée.
Consulter une pluralité de sources (scientifiques, institutionnelles, contradictoires).
Soumettre l’hypothèse à la vérification empirique : données disponibles, cohérence interne, précédents historiques.
Accepter de la réviser ou de l’abandonner si les faits ou la logique l’infirment.
Ce processus est celui de l’enquête au sens épistémique (Peirce, Dewey), opposé à la “chasse aux preuves” propre aux raisonnements circulaires. Il suppose une attitude intellectuelle faite de prudence, de rigueur et d’autocorrection.
2. Indicateurs d’une méthode défectueuse
À l’inverse, certains symptômes méthodologiques signalent un glissement vers le raisonnement complotiste :
Conclusion préalable à toute investigation (recherche d’éléments confirmatifs uniquement)
Rejet sélectif des sources (ne sont retenues que celles qui vont dans le sens souhaité)
Inversion de la charge de la preuve (“prouve-moi que le complot n’existe pas”)
Non-recevabilité du désaveu (“si tu nies, c’est que tu es complice”)
Ce type de fonctionnement ne relève plus du débat rationnel mais de la stratégie argumentative fermée, fondée sur la conviction préalable.
« L'attitude critique est celle qui admet de pouvoir avoir tort. Le dogmatisme est celle qui exige d’avoir raison contre tous. »
— Raymond Boudon, Le juste et le vrai, 1995
3. L’analogie avec la science : une hypothèse est différent de la vérité
Il peut être utile de rappeler l’analogie avec la pratique scientifique. La science ne fonctionne pas sur des vérités définitives, mais sur des modèles falsifiables, construits collectivement et révisables en fonction de nouvelles données.
Ainsi, une hypothèse “alternative” peut parfaitement être formulée. Mais elle doit :
être testable, c’est-à-dire exposée à des faits qui pourraient l’infirmer ;
rester proportionnée à la qualité des indices dont elle dispose ;
faire mieux que les explications concurrentes en termes de cohérence, simplicité, et portée explicative.
En science comme en philosophie, ce qui fait la force d’un raisonnement, ce n’est pas sa capacité à tout expliquer, mais sa capacité à résister au réel sans se refermer sur lui-même.
III. Faut-il donner la parole aux complotistes ?
A. Les arguments contre : banalisation, confusion, inefficacité
L’une des questions les plus débattues en philosophie politique et en éthique du débat public concerne le statut de la parole complotiste dans l’espace commun. Doit-on la confronter publiquement ? La taire ? La réfuter systématiquement ? Ou, au contraire, la laisser s’effondrer par absence de réaction ?
Dans cette section, nous examinons les arguments critiques à l’encontre d’une stratégie d’ouverture ou de “dialogue” avec les représentants de théories du complot. Ces arguments ne visent pas à censurer, mais à interroger les conséquences collectives de la mise en visibilité de certaines idées.
1. La parole complotiste bénéficie d’un effet de plateforme
Dans une démocratie libérale, la pluralité des opinions est un principe fondamental. Pourtant, toute opinion ne bénéficie pas automatiquement d’un droit à la tribune médiatique. Donner une exposition publique à certaines positions extrêmes ou infondées peut produire un effet de légitimation indirecte, même en contexte critique.
C’est ce que le chercheur Brice Teinturier (Ifop, 2021) appelle l’effet “platforming” :
« L’idée la plus marginale ou minoritaire peut paraître socialement acceptable dès lors qu’elle est exposée dans un cadre de débat public légitime. »
De la même manière, Cass Sunstein (juriste, Harvard) et Adrian Vermeule alertaient dès 2009 sur le risque que la confrontation publique des théories du complot renforce leur crédibilité auprès des convaincus, qui y voient une preuve d’intérêt ou d’inquiétude de l’establishment (Conspiracy Theories, Harvard Public Law Working Paper).
2. La réfutation publique est structurellement désavantagée
Un autre argument contre le dialogue tient à l’asymétrie argumentative. Comme le formule la loi de Brandolini, devenue célèbre en sociologie des réseaux :
« Il faut dix fois plus d’énergie pour réfuter une bêtise que pour la produire. »
Les théories du complot mobilisent souvent des fragments de faits, des allusions, des déductions spéculatives. Elles s’expriment rapidement, de manière émotionnellement engageante. La réponse rationnelle, au contraire, suppose des démonstrations, des références, des données précises – c’est-à-dire du temps, de la pédagogie, et un auditoire attentif.
Dans une société de la captation attentionnelle, cela crée un déséquilibre : le discours rapide, émotionnel, et suggestif a souvent plus d’impact immédiat que la démonstration lente et méthodique, pourtant plus rigoureuse. Ainsi, l’effort pour déconstruire des rumeurs ou des fausses croyances est souvent perçu comme trop tardif, trop complexe, ou suspect.
3. Le débat peut créer une illusion de symétrie
Inviter une personne défendant une thèse complotiste à débattre avec un expert, c’est implicitement placer les deux positions sur un pied d’égalité argumentative. Cela peut induire une fausse équivalence : celle entre une hypothèse non démontrée ou infalsifiable, et une explication fondée sur un consensus scientifique ou factuel.
Le philosophe des sciences Lee McIntyre (Post-Truth, MIT Press, 2018) insiste sur ce danger :
« Quand on donne à voir deux camps opposés, sans contextualiser leur statut épistémique, on crée l’illusion d’un débat scientifique là où il n’y a qu’un différend idéologique. »
4. Le complotisme ne cherche pas le débat, mais la disqualification
Un dernier argument concerne la finalité du discours complotiste. Dans de nombreux cas, celui-ci ne vise pas à convaincre rationnellement, mais à discréditer la possibilité même de la discussion rationnelle. Il se présente comme une dénonciation morale, voire métaphysique, d’un “système” jugé corrompu, menteur, ou complice.
« Ce que veut le conspirationniste radical, ce n’est pas avoir raison, c’est que les autres aient tort. »
— Pierre-André Taguieff, Les Rhétoriques du complot, 2010
Dès lors, ouvrir un débat devient difficile, car les règles mêmes du dialogue – preuves, logique, bonne foi – sont rejetées ou retournées. On n’est plus dans un différend intellectuel, mais dans un conflit de mondes. La parole du chercheur, du journaliste ou du scientifique y est interprétée comme un symptôme du mensonge, et non comme un argument.
B. Les arguments en faveur du dialogue : pédagogie, prévention, responsabilité démocratique
Si les arguments contre la mise en débat des discours complotistes soulignent des risques réels – confusion, plateformisation, déséquilibre –, ils ne suffisent pas à disqualifier toute forme de confrontation raisonnée. Une partie de la littérature en philosophie politique, en psychologie sociale et en pédagogie critique suggère que refuser a priori le dialogue peut renforcer les dynamiques d’adhésion à ces croyances.
Plutôt que de censurer, il s’agirait d’exposer, expliquer, recadrer, dans un cadre rigoureux. Le dialogue, dans ce contexte, devient non pas une validation, mais un outil de désamorçage rationnel.
1. Le silence alimente la défiance
L’absence de réponse explicite aux récits complotistes peut être perçue comme une confirmation implicite. Dans de nombreux entretiens ethnographiques (cf. D. Mercier, CNRS, 2021), des croyants dans certaines théories déclarent :
« Si on ne nous répond pas, c’est bien qu’ils ont quelque chose à cacher. »
Le philosophe Jacques Bouveresse (2012) soulignait déjà qu’un refus de débat peut apparaître comme une forme d’arrogance épistémique : « Vous êtes trop bête pour que je vous réponde. » Or, ce mépris peut aggraver la polarisation et renforcer l’identification au camp des “éveillés”. Répondre, au contraire, c’est refuser de laisser le monopole de la parole aux versions les plus simplificatrices ou émotionnelles.
2. Des effets pédagogiques potentiels
La confrontation rationnelle, même face à une position dogmatique, peut produire des effets indirects :
Pour les spectateurs du débat, elle offre une grille de lecture, une méthode d’analyse, une modélisation de la rigueur.
Pour certains adhérents sincères mais non fermés, elle peut ouvrir des brèches cognitives, faire apparaître des contradictions, et amorcer un doute.
Des études menées par l’Université de Cambridge (Lewandowsky et al., 2017) montrent que la réfutation raisonnée, lorsqu’elle respecte certaines conditions (temps, forme, ton), diminue l’adhésion aux croyances conspirationnistes sur le long terme. Il s’agit notamment de :
Présenter les faits avant les mythes (principe de préexposition),
Expliquer les mécanismes du complotisme (biais cognitifs, bulles informationnelles),
Proposer une version alternative cohérente, plutôt que de simplement nier.
3. Le principe démocratique de publicité du désaccord
Dans une perspective de philosophie politique, refuser le dialogue avec certaines idées jugées “hors du cadre” pose une difficulté démocratique. La démocratie ne consiste pas à valider toutes les opinions, mais à garantir que les conflits puissent être portés sur la scène publique, soumis à des normes de discussion partagées.
« La démocratie n’est pas seulement le règne de la majorité. C’est l’institution du dissensus dans un espace d’arguments. »
— Claude Lefort, L’invention démocratique, 1981
Dans cette logique, le débat public est un espace où même les idées fausses ont une fonction critique, en ce qu’elles obligent les institutions à rendre des comptes, à améliorer la pédagogie, à rendre leurs raisonnements accessibles. C’est pourquoi certains chercheurs (B. Latour, J. Habermas) militent pour une rationalité dialogique, non pour convaincre le complotiste radical, mais pour protéger les conditions du débat collectif rationnel.
4. Des cas de “désadhésion” par le dialogue
Enfin, il existe des témoignages documentés de personnes ayant quitté les milieux complotistes à la suite de confrontations argumentées et bienveillantes. Le sociologue Hugo Micheron (Sciences Po) note des parallèles intéressants entre certains processus de “déradicalisation” idéologique et la sortie de croyances complotistes :
Le changement ne passe pas par l’humiliation, mais par l’examen lent des contradictions internes à la croyance.
Le facteur décisif n’est pas l’autorité du discours, mais la qualité du lien dialogique : qui parle, comment, dans quel contexte.
Les discussions privées (forums, proches, enseignants) sont souvent plus efficaces que les confrontations médiatiques.
Ce que confirme également le rapport de l’UNESCO (2022) sur l’éducation critique aux théories du complot : les espaces sécurisés de débat, où la parole n’est pas ridiculisée mais travaillée, sont les plus propices à la construction d’un esprit critique.
C. Les conditions d’un dialogue intellectuellement productif
Si l’on admet que le refus systématique du dialogue peut s’avérer contre-productif, la question devient alors : dans quelles conditions un échange avec des idées complotistes peut-il produire un effet de clarification, et non de confusion ? Il ne s’agit pas de “débattre pour débattre”, mais de poser un cadre rationnel qui rende la confrontation possible, utile et délibérément formatrice.
Les travaux de philosophie du dialogue, d’éthique de la discussion et de psychologie argumentaire permettent d’identifier trois types de conditions nécessaires : épistémiques, procédurales et relationnelles.
1. Des conditions épistémiques : poser les règles du jeu
Un débat rationnel suppose un socle de règles implicites sur la manière dont on produit et évalue des arguments. Ces règles sont bien connues en philosophie de la science (Popper, Bachelard, Lakatos) et en théorie du discours (Habermas).
Critères minimaux :
La charge de la preuve incombe à celui qui affirme une thèse inhabituelle ou extraordinaire.
Les arguments doivent être accessibles à la vérification ou à la réfutation (principe de falsifiabilité).
Les sources doivent être traçables, plurielles, indépendantes, et soumises à l’examen critique.
Ces règles ne sont pas négociables. Un dialogue est possible si et seulement si les interlocuteurs acceptent de jouer avec les mêmes contraintes cognitives. Autrement dit, le débat peut intégrer des hypothèses audacieuses, à condition qu’elles se prêtent à la discussion rationnelle et ne soient pas fondées sur une autorité indiscutable ou une révélation inaccessible.
2. Des conditions procédurales : structurer l’échange
Le second ensemble de conditions concerne la forme du dialogue, son déroulement et ses cadres temporels ou médiatiques.
Éviter le format “show” (débat en direct, sans temps de vérification), qui favorise la rhétorique au détriment de la rigueur.
Préférer les formats longs, différés, argumentés, où chaque partie peut consulter les sources, vérifier les faits et organiser son raisonnement.
Modérer l’échange selon des principes clairs : égalité de temps, droit de réponse, évitement des attaques ad hominem.
Comme le note Jürgen Habermas, dans Théorie de l’agir communicationnel (1981), la discussion rationnelle suppose des règles de sincérité, de symétrie, et d’orientations vers la vérité. Ces règles doivent être explicitées dès le départ, sans quoi le débat se réduit à un affrontement rhétorique sans portée épistémique.
3. Des conditions relationnelles : instaurer une écoute active et critique
Le dernier niveau de condition concerne la disposition subjective des participants, ce que le philosophe Paul Ricœur appelle “la confiance critique”. Le dialogue n’a de sens que s’il s’appuie sur :
La volonté sincère d’écouter l’argument adverse, même s’il semble erroné ;
Le refus de l’humiliation intellectuelle, qui ferme toute possibilité de doute ou d’évolution chez l’autre ;
La capacité à reformuler les positions de l’autre dans leurs meilleurs termes (principe de charité, Quine/Davidson).
Ce que l’on cherche, ce n’est pas un ralliement idéologique, mais une mise à l’épreuve mutuelle des arguments, dans un cadre où la vérité n’est pas possédée a priori, mais construite dialogiquement.
« Le désaccord rationnel repose sur un respect réciproque des facultés critiques de l’autre. »
— Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, 1990
IV. Méthodes institutionnelles et scientifiques de réponse au complotisme
A. Une préoccupation croissante des institutions
Depuis la seconde moitié des années 2010, le complotisme est devenu un objet de préoccupation explicite pour de nombreuses institutions : État, universités, organismes de recherche, médias publics, organisations internationales. Cela s’explique par :
La montée en puissance des théories du complot dans l’espace numérique et politique
Leur impact social concret : radicalisation, défiance envers la science, désinformation électorale
Le besoin de préserver un espace public fondé sur des critères de vérification partagés
De ce fait, plusieurs méthodes documentées ont été conçues pour lutter contre leur diffusion, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’information, et de la régulation des contenus numériques.
B. L’approche pédagogique : éduquer à l’esprit critique
1. Enseignement moral et civique (EMC)
Depuis 2016, le ministère de l’Éducation nationale français a introduit la question des théories du complot dans les programmes d’enseignement moral et civique (EMC), au collège et au lycée. L’objectif est de :
Sensibiliser les élèves aux biais cognitifs et aux logiques conspirationnistes
Développer des compétences de vérification de l’information
Encourager une posture de doute méthodique, distincte du soupçon radical
2. UNESCO : une stratégie éducative globale
L’UNESCO a publié en 2022 un guide international intitulé :
"Think Critically, Click Wisely: Media and Information Literate Citizens"
Et un autre spécifiquement destiné aux enseignants :
"Lutter contre les théories du complot : ce que les enseignants doivent savoir"
(UNESCO, 2022 – disponible en français)
Ce guide propose une démarche pédagogique en 6 étapes :
Identifier une théorie du complot
Comprendre ses mécanismes
Analyser ses ressorts émotionnels
Comparer les sources
Appliquer une méthode de vérification
Favoriser la discussion critique en classe
🔎 Source : UNESCO Education - Guide contre le complotisme (2022)
C. L’approche scientifique : produire des savoirs sur le phénomène
1. Sociologie et psychologie des croyances
Des chercheurs comme Gérald Bronner (La Démocratie des crédules, 2013) ou Sylvain Delouvée (Université Rennes 2, Pourquoi les gens croient aux théories du complot, 2021) ont élaboré des grilles d’analyse permettant de :
Comprendre les mécanismes cognitifs (biais, heuristiques)
Mesurer l’impact des réseaux sociaux
Cartographier les sociologies de l’adhésion
Les recherches sont souvent appuyées sur des données quantitatives (Ifop, CNRS, Fondation Jean-Jaurès) et des analyses de corpus (forums, vidéos, entretiens).
🔎 Sources :
Bronner, G. (2013). La Démocratie des crédules. PUF.
Delouvée, S. (2021). Pourquoi les gens croient aux théories du complot. Dunod.
2. Cartographies et observatoires
Le site Conspiracy Watch, dirigé par Rudy Reichstadt, en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès, propose :
Des analyses de discours
Des cartographies de réseaux complotistes
Des enquêtes d’opinion (notamment 2017, 2018, 2021)
🔎 Rapport Ifop–Fondation Jean-Jaurès–Conspiracy Watch (2018) :
https://jean-jaures.org/publication/les-francais-et-les-theories-du-complot/
D. L’approche journalistique : vérification et pédagogie
1. Le fact-checking
Les grands médias ont institutionnalisé des cellules de vérification de l’information :
Les Décodeurs (Le Monde)
CheckNews (Libération)
Vrai ou Fake (France Info)
AFP Factuel
Leur méthode repose sur :
L’identification d’une rumeur ou d’un “fait alternatif”
La recherche de sources primaires
L’explication contextualisée de la vérification
2. Le journalisme scientifique
Certains médias spécialisés dans la vulgarisation scientifique (comme Sciences et Avenir, The Conversation, ou La Méthode scientifique sur France Culture) produisent des contenus visant à :
Rendre les preuves scientifiques accessibles
Clarifier les zones d’incertitude légitime
Différencier un débat scientifique d’une spéculation non falsifiable
E. L’approche réglementaire : modération et plateformes
1. Charte européenne de lutte contre la désinformation
La Commission européenne, en partenariat avec les grandes plateformes (YouTube, Meta, TikTok…), a lancé en 2022 un “Code de bonnes pratiques” contre la désinformation, incluant les théories du complot.
Objectifs :
Réduire la visibilité algorithmique des contenus complotistes
Renforcer les liens vers des sources fiables
Étiqueter les contenus douteux
Code of Practice on Disinformation, Commission européenne (2022)
→ https://digital-strategy.ec.europa.eu
2. La France et la régulation par l’ARCOM
L’ARCOM (ex-CSA) a mis en place des obligations de vigilance pour les plateformes numériques, notamment en cas de :
Propagation de fausses informations menaçant l’ordre public
Apologie de la haine via des narrations conspirationnistes (ex : antisémitisme, négationnisme)
Le cadre légal repose sur la loi contre les contenus haineux en ligne (dite loi Avia, 2020), bien que contestée.
Ces méthodes visent à préserver un espace public rationnel, où l’on peut encore débattre, critiquer, s’informer – sans verser dans la croyance cloisonnée ni l’intimidation idéologique. Elles ne sont pas parfaites, et certaines critiques sont légitimes (efficacité, visibilité, accessibilité). Mais elles constituent des cadres solides de réponse aux discours infalsifiables, et des points d’appui pour toute démarche critique rigoureuse.
V – Limites et résistances du fact-checking journalistique
1. Asymétrie cognitive et temporelle
Le fact-checking souffre d'une asymétrie fondamentale : une fausse information se propage rapidement et largement, tandis que sa vérification est souvent complexe et tardive. Comme le souligne une analyse du Le Monde, « une rumeur s’exprime en une phrase choc, la réfutation demande un article de 10 minutes » .Le Monde.fr
Cette dynamique favorise la diffusion des infox, qui exploitent les biais cognitifs tels que le biais de confirmation, rendant les corrections moins efficaces.
2. Perception de partialité et défiance envers les médias
Une part significative du public perçoit les initiatives de fact-checking comme biaisées ou partisanes. Selon une étude du Reuters Institute, la confiance dans les médias traditionnels en France a chuté à 24 % en 2019, avec 55 % des Français estimant que « les médias sont plus soucieux de soutenir une idéologie ou une position politique que d’informer le public » .Wikipédia
Cette défiance est exacerbée lorsque les vérifications sont perçues comme ciblant spécifiquement certains courants politiques, alimentant ainsi le sentiment de censure.
3. Instrumentalisation politique du fact-checking
Le fact-checking est parfois utilisé comme un outil politique, ce qui peut compromettre sa crédibilité. Par exemple, lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle française de 2017, des critiques ont émergé concernant l'utilisation du fact-checking pour discréditer certains candidats, sans toujours fournir une analyse impartiale.
Cette instrumentalisation peut renforcer la méfiance envers les médias et les institutions.
4. Limitations technologiques et erreurs des algorithmes
Les outils automatisés de fact-checking, bien qu'utiles, présentent des limites. Lors de l'incendie de Notre-Dame en 2019, l'algorithme de YouTube a associé les images de l'événement à celles des attentats du 11 septembre, illustrant les erreurs possibles de ces systèmes .La Revue des Médias
Ces erreurs peuvent semer la confusion et diminuer la confiance du public dans les outils de vérification.
5. Pressions et harcèlement des fact-checkers
Les journalistes spécialisés dans le fact-checking sont souvent la cible de harcèlement en ligne, notamment de la part de groupes extrémistes. Des campagnes de cyberharcèlement ont visé des fact-checkers en France, les accusant de partialité ou de collusion avec le pouvoir .Wikipédia
Ces attaques peuvent dissuader les journalistes de poursuivre leur travail de vérification.
Réponses institutionnelles et initiatives en cours
1. Loi contre la manipulation de l'information (2018)
La France a adopté une loi visant à lutter contre la diffusion de fausses informations, notamment en période électorale. Cette loi permet au juge des référés d'ordonner la suppression de contenus manifestement faux diffusés massivement .Le
Cependant, cette législation a été critiquée pour son flou juridique et le risque de censure excessive.
2. Initiatives de transparence des médias
Des médias comme Les Décodeurs du Monde ou CheckNews de Libération s'efforcent de détailler leurs méthodologies et de citer leurs sources, afin de renforcer la transparence et la confiance du public.
Ces efforts visent à montrer que la vérification des faits est un processus rigoureux et impartial.
3. Programmes d'éducation aux médias
Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le CLEMI, développe des programmes d'éducation aux médias et à l'information (EMI) pour sensibiliser les élèves à la vérification des sources et au développement de l'esprit critique.
Ces initiatives visent à former des citoyens capables de discerner les informations fiables des infox.
Limites actuelles de l’approche réglementaire
Malgré les progrès notables, plusieurs problèmes structurels demeurent :
La difficulté à distinguer le faux délibéré du doute légitime, surtout dans les discours ambigus ou insinuants ;
Le manque d’harmonisation entre les États, avec des définitions variables de la “désinformation” ;
Le retard dans la réponse réglementaire : les infox circulent souvent bien avant que les mécanismes de retrait soient activés ;
Le risque de surcensure algorithmique, certains contenus critiques mais légitimes étant supprimés par excès de zèle (ce que certains chercheurs appellent le “chilling effect”).
En résumé, l’approche réglementaire européenne et française cherche à encadrer les pratiques informationnelles sans restreindre le débat d’idées. Elle avance à petits pas : elle responsabilise les plateformes, mais peine encore à rétablir la confiance dans l’espace public. Elle protège, mais ne suffit pas à former. C’est pourquoi l’éducation, la recherche, le journalisme et l’enquête collective — comme nous la proposerons ensuite — doivent prendre le relais.
VI. La démocratie comme cadre de la recherche critique
VI.A. Penser la démocratie à partir du désaccord rationnel
Tout au long de cet article, une idée centrale a émergé : la lutte contre le complotisme n’est pas seulement un enjeu d’éducation, de régulation ou de journalisme. Elle touche directement à la forme même de nos régimes politiques. En d’autres termes, elle interroge la démocratie comme condition de possibilité d’un espace public rationnel.
VI.A.1. La démocratie ne se limite pas à voter
Dans le langage courant, la démocratie est souvent réduite au droit de vote ou à l’alternance électorale. Cette définition minimale est juridiquement exacte, mais philosophiquement insuffisante. Comme l’a montré Claude Lefort, la démocratie est d’abord un régime du conflit légitime, un vide du pouvoir ouvert à la contestation, où aucun discours ne peut s’imposer comme sacré.
« La démocratie, c’est l’institution d’un espace où le pouvoir est mis en question par ceux-là mêmes qui y participent. »
— Claude Lefort, L’invention démocratique, 1981
Ce cadre suppose non pas l’unanimité, mais la possibilité du désaccord raisonné. Or, c’est précisément ce que le complotisme radical rend impossible : il transforme toute opposition en trahison, tout débat en diversion, et toute critique en manipulation. La démocratie suppose au contraire que les idées soient soumises à la critique, non disqualifiées d’avance, ni sanctifiées.
VI.A.2. Ce n’est pas le vote qui garantit la démocratie, mais l’espace où l’on peut débattre
Il est tout à fait démocratique de soutenir un parti minoritaire, non représenté médiatiquement, voire en rupture avec le système parlementaire dominant. Voter pour l’UPR, par exemple, n’a rien d’illégitime — à condition que l’adhésion à ce projet s’accompagne d’un travail critique sur ses thèses, ses sources, et sa cohérence.
Ce qui distingue un engagement politique démocratique d’une posture complotiste, ce n’est pas le contenu des idées, mais la manière dont on les soutient : est-ce qu’on les expose à la critique ? Est-ce qu’on accepte de les voir réfutées ? Est-ce qu’on les fonde sur des faits, ou sur une conviction imperméable ?
Le pluralisme démocratique suppose la coexistence de points de vue opposés, mais soumis à des critères communs de rationalité, de preuve, de responsabilité argumentative. Il n’exige pas de croire aux institutions, mais de ne pas les rejeter par principe sans examen.
3. Montrer, plutôt que cacher : une inversion fondamentale du rapport à la vérité
L’un des ressorts fondamentaux du complotisme est l’idée que “on nous cache tout”. L’opposition structurante devient alors : “eux” (les institutions, les médias, les élites) mentent, “nous” (les éveillés) savons. Cette structure est auto-confirmatrice : plus la vérité contredit la croyance, plus elle est interprétée comme une preuve que la dissimulation continue.
C’est pourquoi une posture démocratique exige une inversion radicale : non pas dire que tout est transparent (ce serait naïf), mais dire que tout est accessible, pour qui veut chercher avec méthode. L’information n’est pas révélée par des initiés — elle est déjà disponible, mais dispersée, confuse, technique, ou mal interprétée.
« Ce n’est pas la vérité qui est cachée : ce sont nos outils de lecture du réel qui sont souvent mal formés, insuffisants, ou disqualifiés d’emblée. »
— Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité, 1996
Cette démarche est profondément démocratique, car elle suppose que chacun a la capacité d’accéder à la vérité, non pas immédiatement, mais par une enquête collective, méthodique, contradictoire. Elle suppose l’égalité des intelligences, mais aussi la reconnaissance de la complexité.
C’est cette posture que nous avons modélisée tout au long de nos articles : poser des questions, chercher des réponses, confronter les sources, admettre ce que l’on ne sait pas, accepter de réviser une croyance. Cette démarche ne vient pas d’en haut, elle ne s’impose pas, elle s’offre — elle est publique, documentée, ouverte à la contradiction.
En cela, elle réalise ce qu’est la démocratie au sens épistémique du terme : un régime de discussion, non de croyance.
VI.B — La vérité comme bien commun, l’enquête comme exercice collectif
Si la démocratie repose sur la possibilité d’un désaccord rationnel, elle implique également une certaine conception de la vérité : non pas comme donnée révélée, mais comme objet de construction collective. Cette idée, profondément liée à l’histoire de la philosophie, des sciences et du droit, entre en conflit frontal avec les représentations complotistes, qui posent une vérité cachée, totale, détenue par quelques-uns.
1. Vérité, enquête, et espace public
Dans une démocratie, la vérité ne peut pas être l’affaire d’un pouvoir unique ou d’un “gardien du réel”. Elle se constitue dans un processus lent, révisable, délibératif, où les affirmations sont soumises à la contradiction. C’est la conception que défend John Dewey, philosophe pragmatiste, lorsqu’il définit la démocratie comme “le mode de vie dans lequel l’enquête collective est le fondement de toute décision publique” (The Public and Its Problems, 1927).
« La vérité n’est pas ce que l’on possède, mais ce que l’on vérifie. Elle est le produit d’un effort partagé de compréhension du monde. »
— John Dewey
Dans cette optique, enquêter n’est pas un acte individuel héroïque, mais une pratique partagée : on rassemble des faits, on les discute, on les publie, on les confronte. C’est ce que font les journalistes d’investigation, les chercheurs, les juges, les enseignants, les citoyens bien formés. Ce n’est pas une autorité extérieure, c’est un processus public.
2. Le complotisme comme clôture du processus d’enquête
Les discours conspirationnistes, ferment l’enquête au moment même où ils prétendent l’ouvrir. En proclamant que “tout est faux” ou que “tout est manipulé”, ils empêchent la vérification. La posture complotiste radicale consiste à remplacer la démonstration par l’intuition, la preuve par la suspicion, l’effort critique par l’effet d’évidence.
Pierre-André Taguieff a montré que ce type de discours fonctionne comme une structure de clôture cognitive : « La théorie du complot offre une réponse globale, totalisante et indiscutable à des questions mal posées. » (Les Rhétoriques du complot, 2013)
En ce sens, le complotisme n’est pas un excès de critique — c’est un refus de méthode.
3. Enquêter ensemble : vers une éthique de la coopération intellectuelle
Réhabiliter l’enquête comme pratique démocratique suppose donc une éthique de la coopération intellectuelle. Cela signifie plusieurs choses :
Ne pas chercher seul contre tous, mais avec d’autres, avec des règles partagées.
Se méfier de ses propres biais avant de dénoncer ceux des autres.
Reconnaître ses erreurs sans y voir une humiliation, mais une progression.
Admettre les désaccords sans soupçonner automatiquement une dissimulation.
C’est ce que prône Gérald Bronner, lorsqu’il appelle à la création d’un “espace public épistémique” : un lieu où les idées sont évaluées selon leur robustesse argumentative, leur degré de preuve, leur cohérence avec les faits. (La Démocratie des crédules, 2013)
« Ce n’est pas l’opinion qui est en danger aujourd’hui, c’est la capacité à hiérarchiser rationnellement les croyances. »
— Gérald Bronner
4. Une vérité sans autorité, mais avec méthode
Enfin, il est fondamental de rappeler que chercher la vérité n’est pas chercher une certitude absolue. La vérité, dans les sciences comme dans la démocratie, est un horizon mobile, un processus de révision permanente. Ce qui compte, ce n’est pas d’avoir “raison contre tous”, mais d’être prêt à ajuster ce que l’on croit à ce que l’on peut démontrer.
C’est ce que résume Karl Popper dans sa définition de la connaissance scientifique :
« La science ne progresse pas en établissant des vérités certaines, mais en éliminant des erreurs. Elle avance par conjectures et réfutations. »
— K. Popper, Conjectures et Réfutations, 1963
Appliquer ce principe à l’espace public, c’est concevoir la démocratie comme un dispositif de correction collective des illusions, et non comme une chambre d’écho des certitudes. C’est aussi ce qui différencie une communauté de recherche d’une communauté de croyance.
VII. Une méthode possible : enquête collective, assistée par outils neutres et orienté par des Humains
A. Présentation de la méthode : enquête pluraliste, appuyée sur l’intelligence artificielle
À la lumière des sections précédentes, une question émerge : comment enquêter rationnellement sur des sujets sensibles, complexes, parfois suspects ou instrumentalisés, sans tomber dans la clôture idéologique ni dans la crédulité aveugle ?
Dans un contexte d’infobésité, de fragmentation des sources et de défiance accrue à l’égard des autorités, il devient nécessaire de formaliser une méthode épistémique alternative, accessible au grand public et fondée sur trois principes :
Documentée (ancrée dans des sources vérifiables)
Pluraliste (ouverte à la contradiction)
Neutre dans la forme (procéduralement impartiale, même si les contenus débattus ne le sont pas)
C’est dans ce cadre qu’intervient la possibilité d’une méthode d’enquête collective assistée par intelligence artificielle, à laquelle nous proposons de donner ici une forme principielle.
1. Hypothèse de travail : l’IA comme médiateur cognitif
L’intelligence artificielle générative, lorsqu’elle est correctement encadrée, peut jouer un rôle de médiateur de l’information, non de juge de vérité. Elle ne “décide” pas ce qui est vrai ou faux, mais :
Recueille les éléments documentés existants (rapports, publications, sources institutionnelles),
Structure des réponses comparatives (positions opposées, angles différents),
Répond à des questions sans intentionnalité idéologique.
Cette posture algorithmique permet une forme de neutralité procédurale, utile dans des situations où les sources humaines sont perçues comme orientées ou partiales.
« L’IA n’est pas un oracle. Elle est un miroir dialectique, qui reflète les discours, mais peut aussi les mettre en tension. »
— Judith Simon, Université de Hambourg, 2022
2. Une démarche collective et méthodique
La méthode s’organise en étapes réflexives successives, dans une logique inspirée des modèles de recherche scientifique et des théories de l’agir collectif (Latour, Habermas, Dewey) :
Étape 1 — Formuler une question ou une hypothèse claire
Ex. : “L’homme a-t-il réellement marché sur la lune ?”
Non pas pour y répondre immédiatement, mais pour la décomposer en sous-problèmes vérifiables (preuves matérielles, contre-arguments, sources alternatives).
Étape 2 — Collecter les positions divergentes
L’IA peut fournir :
Les arguments historiques, techniques, institutionnels appuyant la version dominante ;
Les arguments critiques, alternatifs, contestataires (dans la mesure où ils sont documentés), sans les valider ni les rejeter d’emblée.
Étape 3 — Identifier les sources, les auteurs, les contextes
Chaque argument peut être attribué à une source : un chercheur, un organisme, un rapport, un journal. Cela permet d’objectiver les positions et d’éviter les généralisations floues.
Étape 4 — Vérifier la cohérence, les liens logiques, les points aveugles
À ce stade, la discussion devient épistémique : quelles affirmations sont falsifiables ? Les prémisses sont-elles cohérentes ? Quelles sont les hypothèses implicites ? Qu’est-ce qui est prouvé, probable, spéculatif ou infalsifiable ?
Étape 5 — Discuter collectivement les résultats, formuler des zones d’incertitude ou de convergence
Ce n’est qu’à la fin que peut être proposé un diagnostic rationnel : où se situent les désaccords ? Où manque-t-on de données ? Qu’est-ce qui reste discutable, mais falsifiable ? Cette démarche ne produit pas “la vérité”, mais un espace commun de réflexivité structurée.
VII.B — Une méthode d’enquête collective assistée : validité, portée et limites
Après avoir présenté les méthodes pédagogiques, scientifiques, journalistiques et réglementaires, une question s’impose : comment le citoyen ordinaire, hors cadre institutionnel, peut-il s’informer, investiguer et penser sans dériver vers le soupçon dogmatique ?
L’une des réponses possibles réside dans l’usage encadré des outils d’intelligence artificielle générative, comme ceux proposés par des systèmes de type GPT. Non pas comme oracles de vérité, mais comme agents de structuration et de documentation du raisonnement.
1. Que peut faire une IA dans une enquête critique ?
Contrairement à une croyance répandue, l’IA ne “pense” pas. Elle ne juge pas, n’a pas d’intention, ne croit rien. Elle peut en revanche :
Fournir un accès rapide à une pluralité de sources fiables, si elles sont indexées et vérifiées.
Structurer un questionnement, en décomposant une hypothèse en sous-questions.
Restituer des positions divergentes sur un sujet donné, sans imposer de hiérarchie a priori.
Identifier des lacunes argumentatives, des biais fréquents, ou des raisonnements circulaires.
En cela, l’IA peut jouer un rôle méthodologique : elle n’invente pas la vérité, mais elle aide à mettre les conditions de son examen en place.
2. Les forces de cette méthode
a. Démocratisation de l’enquête
Grâce à ces outils, n’importe quel citoyen peut accéder, en quelques minutes, à :
Des rapports institutionnels (OMS, CNRS, ONU…),
Des positions contradictoires sur une question controversée (ex. : 11-Septembre, vaccins, géopolitique),
Des résumés d’ouvrages complexes ou peu accessibles.
Cela permet de désenclaver l’accès à l’expertise, sans dépendre exclusivement des canaux médiatiques.
b. Neutralité procédurale
L’IA n’a pas d’idéologie. Elle peut reproduire des biais si les données d’origine en sont saturées, mais elle ne “penche” pour aucun camp. Cela lui permet, lorsqu’elle est bien utilisée, de présenter un débat sans en manipuler les termes.
c. Structuration de la pensée
En posant des questions successives, l’utilisateur est amené à :
Clarifier ses hypothèses,
Identifier les sources qu’il mobilise ou ignore,
Confronter ses intuitions à des contre-arguments,
Accepter de suspendre son jugement sur les points incertains.
3. Les limites épistémologiques
a. Dépendance aux corpus d'entraînement
Une IA générative est formée sur des corpus préexistants. Cela implique :
Une dépendance aux choix de données effectués par ses concepteurs,
Un possible biais de sur-représentation des discours dominants,
Une inégalité d’accès à certains types de publications (notamment dans les domaines critiques ou non académiques).
b. Absence de jugement critique autonome
L’IA ne sait pas si une source est politiquement biaisée, méthodologiquement fragile, ou stratégiquement manipulatrice — sauf si ces informations sont présentes dans les documents d’origine.
Elle ne peut pas détecter l’intentionnalité stratégique d’un discours (ex. : manipulation idéologique), ni analyser un contexte politique ou émotionnel fin.
c. Risque de validation de l’illusion de rigueur
Parce que l’IA produit des réponses bien structurées, avec des références, elle peut donner l’impression de véracité, même sur des questions mal posées ou fondées sur des prémisses discutables.
Ce risque est d’autant plus grand si l’utilisateur ne reformule pas ses questions, ou n’évalue pas les sources mentionnées.
4. Enjeux éthiques et recommandations d’usage
L’IA ne remplace ni la recherche, ni le débat, ni l’éducation. Mais elle peut constituer un outil d’appoint puissant, si elle est utilisée dans une logique :
De pluralisme informationnel (ne pas s’enfermer dans un seul type de réponse),
De vérification croisée (suivre les sources, consulter les liens originaux),
De patience cognitive (prendre le temps de comparer, de reformuler, de douter).
C’est pourquoi cette méthode doit être pensée comme une pratique collective : on interroge, on reformule, on doute ensemble. C’est moins un service qu’un dispositif de conversation critique.
VII.C Analyse d’un prompt-type des Eternels Apprentis : structure et exigences
Voici une formulation typique que nous employons dans toutes nos recherches approfondis GPT-PRO :
« Sans parti pris. Fais une recherche approfondie sur [sujet].
Donne-moi un maximum de sources officielles, documentées et sources académiques.
Donne les arguments de tous les partis, répond de manière officielle.
Évoque les questions rationnelles qui demeurent.
Sur un ton léger, informatif, pour grand public. Sur fonds académique. Fais un article archi structuré. »
Cette formulation contient plusieurs éléments méthodologiquement robustes :
Neutralité procédurale demandée explicitement (“sans parti pris”) ;
Recherche de documentation plurielle et traçable (“sources officielles”, “académiques”, “documentées”) ;
Principe du contradictoire (“donne les arguments des complotistes et réponds”) ;
Reconnaissance de la zone grise rationnelle (“évoque les questions qui demeurent”) ;
Forme structurée et didactique (“article archi structuré”, “ton léger, informatif”).
Cette manière de “prompt” traduit donc une demande d’enquête raisonnée, équilibrée et accessible, exactement dans l’esprit de la tradition critique des Lumières et de la philosophie des sciences.
2. Une démarche rationnelle et démocratique
Le fait même de demander une recherche contradictoire documentée est, en soi, un acte épistémologiquement sain. Cela correspond aux exigences formulées par :
Karl Popper, pour qui une hypothèse doit être confrontée à sa réfutation possible (Conjectures et Réfutations, 1963) ;
Jürgen Habermas, qui fait du débat rationnel fondé sur des arguments vérifiables le cœur de la démocratie délibérative (Théorie de l’agir communicationnel, 1981) ;
Gérald Bronner, qui encourage la “hiérarchisation des croyances selon leur degré de vérifiabilité” (La Démocratie des crédules, 2013).
Par ailleurs, notre formulation reconnaît une distinction essentielle : on peut entendre une hypothèse dissidente sans y adhérer, et admettre les limites du savoir sans verser dans le relativisme. Cette posture, à la fois prudente et curieuse, est ce que les épistémologues contemporains appellent une rationalité dialogique ou inférentielle.
3. Limites de cette méthode par prompt
Même bien formulée, cette méthode n’est pas exempte de limites. Plusieurs points doivent être soulignés :
a. Limites de l’IA elle-même
L’IA ne peut pas “vérifier” la validité intrinsèque d’un argument : elle peut exposer, structurer, restituer, mais pas arbitrer.
Elle dépend de la qualité et de la diversité de ses sources (ce qui varie selon les corpus et les mises à jour).
b. Risque de surcharge ou de simplification
La demande “donne-moi un maximum de sources” peut produire un effet de liste non hiérarchisée si l’IA n’est pas bien guidée.
Le souhait de structuration maximale (“article archi structuré”) peut parfois induire une mise en forme persuasive qui masque la complexité ou l’incertitude.
c. Dépendance aux formulations implicites
Si le prompt n’explicite pas certaines définitions clés (“complotisme”, “source fiable”, “officiel”), l’IA peut reproduire des biais systémiques sans s’en rendre compte.
4. Une bonne pratique de départ
Malgré ces limites, cette manière de questionner une IA constitue un excellent point de départ méthodologique. Elle repose sur les critères fondamentaux de toute recherche sérieuse :
Formulation claire du problème ;
Pluralité des perspectives ;
Appui sur des sources accessibles et vérifiables ;
Refus de la conclusion hâtive ;
Construction d’un raisonnement progressif, structuré, falsifiable.
« L’esprit critique ne consiste pas à tout contester : il consiste à exiger des raisons pour croire. Et à en donner quand on affirme. »
— Pascal Engel, La dispute, 2019
Ce type de prompt crée les conditions d’un espace rationnel, même sur des sujets sensibles, à condition que le lecteur reste actif, critique, prêt à re-vérifier les sources mentionnées et à reformuler ses questions.
VII.D — Intelligence artificielle et enquête critique : de la technologie à la méthode
L’usage de l’intelligence artificielle (IA) comme outil d’aide à la pensée critique marque une transformation du rapport à l’enquête dans les sociétés numériques. Contrairement à l’idée selon laquelle l’IA serait une autorité substitutive de la vérité, elle peut — lorsqu’elle est bien employée — accompagner une posture intellectuelle rigoureuse : vérification, structuration, pluralisme, et prudence.
C’est particulièrement vrai dans le cadre d’enquêtes portant sur des sujets controversés. Le recours à des modèles conversationnels avancés, comme GPT-4 ou GPT-4o dans leur version professionnelle (ChatGPT Pro), permet non pas de “démasquer” une vérité, mais de construire des espaces de réflexion argumentée.
1. Qu’est-ce qu’un modèle comme GPT et comment fonctionne-t-il ?
GPT (Generative Pre-trained Transformer) est un modèle de langage probabiliste entraîné par OpenAI sur un vaste corpus de textes issus du Web, d’ouvrages académiques, de bases juridiques, de documents publics, etc. Il ne pense pas, ne sait rien : il génère des réponses à partir de motifs statistiques appris.
Le modèle GPT-4 (déployé dans ChatGPT Pro) dispose d’une capacité élargée à :
synthétiser des documents complexes,
repérer les contradictions dans un discours,
restituer des points de vue opposés de façon formellement équilibrée,
manipuler des concepts abstraits (philosophie, logique argumentative),
travailler à partir de prompts structurés.
« GPT-4 affiche des performances de niveau humain sur de nombreux critères professionnels et académiques »
— OpenAI Technical Report, 2023 (source)
2. Que permet ChatGPT Pro dans une démarche de recherche critique ?
L’abonnement ChatGPT Pro donne accès aux modèles les plus performants (GPT-4 Turbo, puis GPT-4o), avec les fonctionnalités particulièrement adaptées à l’analyse de diverses théories, car elles permettent de :
Récupérer les sources contradictoires,
Analyser les structures argumentatives (validité logique, circularité, infalsifiabilité),
Contextualiser historiquement un discours (origine d’un mythe, évolution d’un récit),
Comparer les points de vue avec des sources référencées (rapports publics, publications scientifiques, etc.).
3. L’exemple de notre prompt : une pratique méthodologique encadrée
À travers tout cet article, une même méthode de formulation a été utilisée. Elle repose sur une structure typique, explicitement formulée ainsi (reprenons-la ici) :
« Sans parti pris. Fais une recherche approfondie sur [sujet]. Donne-moi au maximum de sources officielles, documentées et académiques. Donne les arguments de toutes les contradictions et réponds de manière officielle. Évoque les questions rationnelles qui demeurent. Sur un ton léger, informatif, grand public. Sur fonds académique. Fais un article archi structuré. »
Ce prompt constitue une mise en forme procédurale du doute méthodique, conforme à plusieurs principes de l’épistémologie contemporaine :
Il impose la neutralité formelle (sans parti pris) ;
Il exige la pluralité des sources, et leur traçabilité (sources officielles, académiques) ;
Il assume la présence d’un contradicteur dans le raisonnement (arguments complotistes) ;
Il distingue le doute légitime de la croyance dogmatique (évoque les questions rationnelles qui demeurent) ;
Il demande une structuration explicite du discours, non pour simplifier, mais pour rendre visible les étapes de la pensée.
« La rationalité ne consiste pas à trancher ce qui est vrai ou faux une fois pour toutes, mais à se donner les conditions partagées de l’examen. »
— Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, 1999
Ce type de prompt ne fait pas qu’interroger l’IA : il installe une méthode. Il constitue une “forme d’écriture intellectuelle” qui encode des exigences critiques : pas de conclusion précipitée, exposition de l’incertitude, recherche de cohérence argumentative.
4. Limites à reconnaître
Cette méthode ne garantit pas l’absence de biais — ni dans les données utilisées par le modèle, ni dans la formulation du prompt lui-même. Il faut être conscient que :
L’IA ne sait pas si un document est factuellement erroné, seulement s’il a été réputé fiable dans son corpus ;
Elle peut reproduire des biais majoritaires (effet de masse, mainstreaming) ;
Elle ne peut pas évaluer l’intention stratégique d’un discours (propagande, diversion, manipulation émotionnelle) sans indications extérieures.
De plus, même bien structuré, un prompt ne remplace pas :
la relecture humaine,
la vérification des sources originales (liens, publications),
ni l’interprétation politique ou éthique des données.
Conclusion
Ce travail a proposé une exploration méthodique du phénomène complotiste : non comme pathologie isolée, mais comme forme de discours, mode d’interprétation du réel, et rapport spécifique à la vérité, à la preuve et au pouvoir.
Nous avons d’abord clarifié les définitions du complotisme, à partir des travaux de Popper, Taguieff, Bronner ou Reichstadt : ce n’est pas croire qu’il existe des complots — ce qui est historiquement attesté — mais penser tout événement comme l’effet caché d’une volonté malveillante, dans un monde où rien ne serait dû au hasard, à l’erreur ou à la contingence.
Nous avons ensuite étudié les critères méthodologiques qui permettent de distinguer la pensée critique légitime de la clôture complotiste. Ce qui sépare les deux n’est ni la défiance, ni la dissidence, mais le respect des conditions du débat rationnel : l’exposition à la contradiction, la vérifiabilité des hypothèses, la transparence des sources, et l’acceptation de l’incertitude.
Nous avons montré que des institutions — l’école, les chercheurs, les médias, les législateurs — ont mis en place des réponses pédagogiques, scientifiques, journalistiques et juridiques. Chacune a ses vertus : formation à l’esprit critique, documentation des récits, modération des espaces publics, responsabilisation des plateformes.
Mais nous avons aussi posé une question centrale : que peut faire un individu seul — ou un collectif — pour penser sans dériver ? C’est ici que nous avons introduit une méthode d’enquête assistée, fondée sur des outils d’intelligence artificielle comme GPT, utilisés non comme oracles, mais comme outils de structuration, de pluralisation des sources et d’accès méthodique à l’information.
Nous avons analysé comment un prompt bien formulé — comme ceux que tu as utilisés : “sans parti pris, recherche approfondie, sources officielles et contradictoires, article structuré” — constitue en soi une démarche épistémique, c’est-à-dire une méthode d’examen, proche des exigences de la recherche scientifique. Il ne s’agit pas ici de croire l’IA, mais de l’utiliser pour penser avec méthode.
Enfin, nous avons rappelé que cette démarche n’est pas seulement intellectuelle : elle est politique. Elle suppose une certaine idée de la démocratie : non pas une adhésion passive à des autorités, mais la possibilité pour chacun de participer à l’examen du monde, dans un cadre partagé de discussion, de vérification, et de pluralisme raisonné.
« La démocratie, ce n’est pas que chacun ait son opinion : c’est que chacun accepte que l’on puisse en discuter. »
— Paul Ricœur, Lectures 3, À l’école du philosophe, 1994
En ce sens, enquêter n’est pas un luxe ni une déviance. C’est l’exercice même de la liberté intellectuelle. Et refuser l’enquête — ou la remplacer par des certitudes infalsifiables — c’est renoncer à ce qui fait la dignité du jugement démocratique.
Nous ne conclurons donc pas sur une “vérité” à adopter, ni sur une liste d’idées “autorisées”, mais sur un principe de méthode :
ne rien croire sur parole, y compris ce que l’on pense soi-même, et se donner les moyens de chercher ensemble ce que l’on peut raisonnablement soutenir, sans céder à la peur, ni au mépris, ni à l’illusion.
Cela s’appelle : penser.
Et c’est la condition de tout vivre-ensemble démocratique, dans la vérité — ou, à défaut, dans l’effort de la construire.
les eternels apprentis
Contact
contact@eternels-apprentis.fr
© 2025. Tous droits réservés.
Un média indépendant, pour agir concrètement