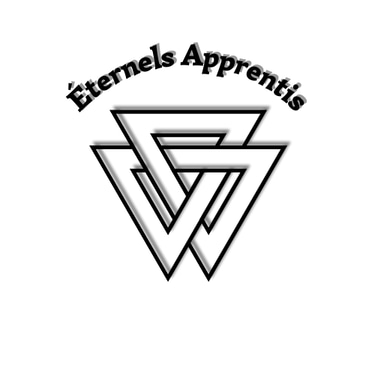Ceci est notre premiere maquette ISSUE DE L'IA ET L'IH.
ameliorons ensemble ce projet, grace a notre intelligence collective et nos reseaux sociaux.
Ce site est une base de travail.
La Laïcité comme cadre de vivre-ensemble, cadre de développement des Eternels Apprentis
22 min read
I. Comprendre la laïcité française
II. Laïcité et christianisme, Laïcité et islam
III. Positionnement des Éternels Apprentis dans le principe de laïcité
Depuis plus d'un siècle, la laïcité constitue un pilier fondamental de la République française, garantissant la liberté de conscience, l'égalité de tous devant la loi, et la neutralité de l'État à l'égard des convictions religieuses ou philosophiques.
Dans un contexte où les débats sur la place des religions dans l'espace public sont parfois vifs, notre site "L’Unité" s'engage à respecter pleinement ce principe. Notre objectif est de favoriser la compréhension mutuelle en exposant, de manière factuelle et sans prosélytisme, les différentes convictions qui coexistent au sein de notre société.
Dialoguer ne signifie pas fuir les sujets sensibles. Cela suppose au contraire de s’écouter sincèrement les uns les autres, de comprendre sur quoi reposent les croyances, les doutes, les critiques. C’est précisément ce que nous cherchons à faire ici : donner à chacun les moyens de comprendre ce que l’autre croit ou rejette, pour que les désaccords — s’il y en a — soient informés, fondés, respectueux.
Nous croyons que le débat public ne s’élève que lorsqu’il repose sur des faits vérifiables, des sources claires, et une volonté d’apprendre. Il ne s’agit pas de croire, mais de savoir de quoi l’on parle. C’est aussi ça, le dialogue. C’est aussi ça, la République.
C’est pourquoi nous avons choisi de rassembler les faits connus, documentés, vérifiables sur les différentes religions, visions du monde et arguments philosophiques. Non pour hiérarchiser les convictions, mais pour créer un socle commun de compréhension. Ce travail d’exposition, s’il est honnête, renforce la laïcité : il permet à chacun de coexister en paix dans une société pluraliste, où l’on peut croire, ne pas croire, douter ou changer — sans exclusion ni hostilité.
I. Comprendre la laïcité française
A. Définition et principes fondamentaux
La laïcité, dans le cadre juridique français, repose sur trois piliers indissociables :
La liberté de conscience :
Chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer de religion ou de ne suivre aucun courant spirituel.
→ Ce principe inclut aussi bien la liberté de culte que la liberté de ne pas pratiquer.La neutralité de l’État :
L’État, ses administrations et ses agents (enseignants, fonctionnaires...) ne doivent favoriser aucune conviction religieuse ni idéologie particulière.
→ Cela ne signifie pas que la religion est exclue de l’espace public, mais qu’elle ne doit jamais être promue ni combattue par l’institution elle-même.L’égalité de tous devant la loi :
Aucune distinction ne peut être faite entre citoyens en raison de leur foi, origine religieuse ou non-croyance.
→ Ce principe garantit que la religion, comme l’irréligion, reste strictement dans le domaine du choix personnel.
Ces principes sont affirmés notamment par la loi du 9 décembre 1905 (loi de séparation des Églises et de l’État) et rappelés dans l’article 1er de la Constitution française de 1958 :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »
B. Un cadre juridique protecteur, pas une interdiction de parole
Contrairement à certaines idées reçues, la laïcité ne signifie pas qu’il faut taire la religion, ni l’effacer de toute discussion publique.
Elle garantit simplement que :
Personne n’est contraint à entendre un discours religieux, ni à le subir dans une relation d’autorité (par exemple à l’école, à l’hôpital, à la mairie),
Mais aussi que chacun peut s’exprimer librement sur sa foi ou ses convictions, dans le respect des lois (liberté d’expression, non-diffamation, ordre public).
Le Conseil d’État et l’Observatoire de la laïcité (remplacé par le Comité interministériel depuis 2021) ont souvent rappelé que :
La laïcité n’est pas un athéisme d’État. Elle n’impose ni la foi, ni l’absence de foi.
Parler de Dieu, de la foi, du doute, des textes religieux ou des arguments athées n’est pas un privilège, c’est un droit fondamental en République française. Et ce droit s’appuie sur des bases juridiques claires.
La liberté d’expression : un droit constitutionnel
Article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. »
Ce principe est repris dans :
La Constitution française de 1958,
La Convention européenne des droits de l’homme (article 10),
Et consolidé par de nombreuses décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
Ce droit couvre l’expression :
Des opinions religieuses,
Des critiques philosophiques,
Des interprétations scientifiques,
Et même des croyances minoritaires, impopulaires ou controversées, tant qu’elles ne violent pas l’ordre public ou n’incitent pas à la haine.
La laïcité ne limite pas l’expression, elle limite l’imposition
La laïcité française interdit à l’État de promouvoir une religion, mais elle n’interdit jamais aux citoyens ou aux collectifs privés de parler de religion, y compris publiquement.
Ce que dit la loi :
On peut parler de Jésus, du Coran, de Moïse, du Bouddha, de l’athéisme ou du doute métaphysique,
Tant qu’on le fait sans incitation à la haine,
Sans pression sur autrui,
Et sans confondre espace privé et pouvoir institutionnel.
Il est donc parfaitement légal — et légitime — de proposer, sur une plateforme privée comme "L’Unité", des articles :
sur les miracles chrétiens ou les prophéties bibliques,
sur l’origine du Coran selon les musulmans,
sur les critiques formulées par les athées,
sur les ponts historiques entre traditions.
Tout cela relève de l’étude, de la liberté intellectuelle, et du droit à l’expression des convictions dans le cadre laïque.
Comme le résumait le juriste Jean Rivero, co-auteur du concept de laïcité ouverte :
“La laïcité protège l’État de l’emprise religieuse, mais elle protège aussi les religions de l’emprise de l’État.”
II. Laïcité et christiannisme, laïcité et islam
II. A — Laïcité et christianisme : entre héritage, tensions et recompositions
1. Un lien historique profond… et conflictuel
La France moderne s’est construite avec le christianisme, notamment le catholicisme romain, religion dominante en Europe occidentale pendant plus d’un millénaire.
a. La monarchie « de droit Divin »
Jusqu’au XVIIIᵉ siècle, le pouvoir royal est officiellement fondé sur la volonté de Dieu. Le roi de France est « lieutenant de Dieu sur terre ». L’Église catholique exerce une influence politique, sociale et culturelle majeure :
elle contrôle l’enseignement,
régule les mariages,
gère l’état civil,
et inspire la législation.
b. La Révolution française (1789) : début de la rupture
La Révolution remet en cause ce lien étroit entre pouvoir et religion :
Déclaration des droits de l’homme (1789) :
“Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public.” (article 10)
Nationalisation des biens du clergé,
Création du clergé constitutionnel,
Et surtout, un tournant radical sous la Terreur (1793–94), où certains révolutionnaires comme Robespierre poussent à la déchristianisation, allant jusqu’à remplacer le culte catholique par le culte de la Raison ou de l’Être suprême.
2. Le XIXe siècle : retour progressif de l’Église, puis affrontement avec la République
a. Le Concordat de 1801
Sous Napoléon Bonaparte, l’État signe un accord avec le pape Pie VII :
Le catholicisme est reconnu comme « religion de la majorité des Français »,
L’Église est à nouveau autorisée, mais les prêtres sont nommés et rémunérés par l’État.
C’est une forme de compromis : pas de religion d’État, mais une religion subventionnée et contrôlée.
Ce Concordat restera en vigueur pendant un siècle.
b. La montée de la République laïque (1870–1905)
Avec la IIIe République, l’opposition entre cléricaux (catholiques monarchistes) et républicains laïcs devient centrale.
Les lois républicaines s’affirment :
Loi Jules Ferry (1881–1882) : école gratuite, obligatoire, laïque → exclusion des religieux de l’enseignement public
Loi de 1901 : encadrement des associations (dont les congrégations)
Loi de 1905 : Séparation des Églises et de l’État
“La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.”
— Article 2, loi du 9 décembre 1905
Cette loi est perçue comme un traumatisme par l’Église catholique, qui y voit une agression contre son statut séculaire.
Les relations entre l’État et l’Église sont alors glaciales. Le clergé boycotte certaines cérémonies officielles ; l’enseignement privé catholique devient un enjeu de bataille culturelle.
3. XXe siècle : de l’opposition à la réconciliation progressive
a. Une lente pacification
Après les tensions du début du siècle, les relations s’apaisent :
Les lois laïques ne suppriment pas la religion, elles la relèguent à la sphère privée.
Le catholicisme s’adapte peu à peu à la modernité.
Dans les années 1950–60, le concile Vatican II (1962–65) marque une évolution importante :
“L’Église respecte et promeut la liberté religieuse comme un droit fondamental.”
— Dignitatis Humanae, déclaration conciliaire (1965)
b. La reconnaissance de la laïcité par l’Église catholique
En 2005, le pape Benoît XVI, alors cardinal, déclarait :
“La laïcité est une conquête de la civilisation.”
En 2019, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, affirmait :
“Nous tenons à la laïcité. [...] Elle est un cadre qui permet à toutes les croyances de coexister.”
L’Église catholique française ne conteste plus la laïcité en tant que telle, mais insiste sur le respect :
de la liberté d’expression religieuse,
du droit à l’éducation religieuse,
et de la reconnaissance de la dimension spirituelle dans l’espace public.
II. B — Laïcité et islam : entre principes, tensions et réalités sociales
Bien que la laïcité concerne toutes les croyances, elle est souvent mobilisée dans l’espace public autour de l’islam. Cela s’explique par :
La visibilité croissante de l’islam (voile, halal, prières, lieux de culte),
Les amalgames avec les questions de sécurité et de terrorisme,
Une méconnaissance générale de la religion musulmane dans le débat médiatique.
Selon une étude IFOP (2024), 73 % des Français estiment que l’islam respecte mal la laïcité, contre 20 % pour le catholicisme et 5 % pour le judaïsme.
Cela révèle non seulement une crise de confiance, mais aussi une asymétrie dans la façon dont les religions sont perçues.
1. Un rapport plus récent à la laïcité française
Contrairement au christianisme ou au judaïsme, l’islam n’a pas été partie prenante du long processus historique ayant conduit à la laïcité en France (Révolution, Concordat, loi de 1905). Il est arrivé dans l’histoire française principalement à partir de la colonisation, puis de l’immigration.
a. L’islam en contexte colonial
Dans les colonies (Algérie, Maroc, Afrique subsaharienne), la France n’a pas appliqué la laïcité de manière égale.
L’islam y était surveillé, instrumentalisé ou encadré. En Algérie par exemple, les mosquées étaient sous tutelle de l’État.
La méfiance administrative de l’époque coloniale envers l’islam a laissé des traces : le rapport entre islam et autorité publique commence sous le signe du soupçon.
b. L’islam en métropole : une présence sociologique croissante
L’islam est devenu la deuxième religion de France à partir des années 1960–70, avec l’arrivée de populations maghrébines, turques, comoriennes, etc.
Cette présence visible (lieux de prière, jeûne, fêtes religieuses, pratiques alimentaires, port du voile…) a suscité des débats inédits sur la compatibilité entre islam et laïcité.
2. Le cadre juridique
a. Le principe : l’islam doit respecter la loi de 1905, comme toute religion
En théorie, l’islam bénéficie des mêmes droits que les autres cultes : liberté d’organisation, possibilité d’acheter des lieux de culte, liberté d’expression religieuse.
Toutefois, il n’existait pas de structure officielle représentant l’islam en France avant les années 2000.
Ce que dit la loi :
Dans l’espace public en général (rue, commerce, etc.) : chacun est libre de manifester ses convictions religieuses.
Dans l’espace public institutionnel (école, mairie, hôpital, service public) : les agents sont tenus à la neutralité stricte, et les élèves dans les établissements publics n’ont pas le droit de porter de signes religieux ostensibles depuis la loi de 2004.
b. Les spécificités (et tensions)
L’islam n’a pas bénéficié du Concordat de 1801 (toujours en vigueur en Alsace-Moselle pour le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme).
Il n’a pas de système de financement historique comme certaines autres religions (pas de patrimoine, pas de clergé reconnu par l’État).
→ Cela crée des difficultés concrètes :
financement des mosquées,
formation des imams,
représentation nationale (création du CFCM en 2003, Conseil national des imams en débat),
encadrement des associations cultuelles.
3. Les débats récurrents : pratiques religieuses et visibilité musulmane
a. Le port du voile
Depuis 1989 (affaire de Creil), le voile est au centre des polémiques laïcité/islam.
La loi de 2004 interdit les signes religieux ostensibles à l’école publique → vise surtout le voile.
Le débat se poursuit : accompagnatrices scolaires, université, burkini, etc.
→ Le voile est souvent perçu comme un test de compatibilité avec la République, à tort ou à raison.
b. Le halal, le ramadan, les horaires genrés
Ces pratiques sont légales mais parfois présentées dans l’espace public comme problématiques, en lien avec la notion de “séparatisme”.
Des cantines scolaires à la gestion des salles de sport, ces questions alimentent des tensions culturelles, mais relèvent rarement d’un problème juridique.
c. La formation des imams
L’État ne peut pas former des imams (séparation de 1905), mais souhaite qu’ils soient formés en France, dans une logique républicaine.
Cela ouvre un débat complexe entre liberté religieuse, lutte contre l’extrémisme, et autonomie du culte vis-à-vis de la République.
4. Quel compatibilité ?
Certains discours publics affirment que l’islam serait “incompatible avec la laïcité”, en raison :
du lien perçu entre politique et religion en islam,
de la place du droit religieux (charia),
ou de la revendication identitaire.
Mais ces accusations généralisantes sont contestées :
a. Par les juristes
Le Conseil d’État rappelle que la laïcité française ne juge pas les religions, mais encadre leurs expressions dans le respect de la loi.
L’islam, comme toute foi, respecte la laïcité tant qu’il n’impose pas ses normes aux autres.
b. Par les acteurs musulmans eux-mêmes
De nombreux responsables musulmans, intellectuels, théologiens et citoyens affirment adhérer pleinement à la laïcité :
“La laïcité est ce qui me permet d’être musulman librement, sans peur, sans chantage, sans privilège.” — (propos d’imam rapportés dans La Croix, 2018)
“L’islam n’impose pas de dominer l’État. Il appelle à vivre avec justice, même dans une société pluriconfessionnelle.” — (Tariq Oubrou, imam de Bordeaux)
c. Mais un climat de défiance persiste
Selon plusieurs enquêtes :
L’islam est la religion qui inspire le plus de méfiance (IFOP, 2024),
Les musulmans disent souvent se sentir tenus à l’écart de la laïcité, voire visés par elle.
5. Une compatibilité possible réelle
La laïcité ne demande pas à l’islam de se “réformer”, mais à ses pratiquants de respecter le cadre commun, comme toute autre conviction :
ne pas imposer de normes religieuses à autrui,
ne pas chercher à modifier les lois civiles,
respecter l’égalité hommes/femmes,
accepter la critique et la diversité de croyance.
→ Pour la majorité des musulmans en France, ces principes sont déjà respectés au quotidien.
Ce sont les exceptions minoritaires (islamisme, séparatisme réel, dérives sectaires) qui alimentent les peurs — et parfois l’injustice des amalgames.
III. Positionnement des Eternels Apprentis dans le principe de laïcité
III. A. Laïcité et "L'Unité"
1. Une ligne claire : respect strict de la laïcité française
Les Eternels Apprentis, à travers le site "L’Unité" affirme sans ambiguïté son respect de la laïcité, dans son sens noble :
liberté de conscience, égalité des convictions, neutralité institutionnelle.
Cela implique que :
Nous ne promouvons aucune croyance particulière.
Nous ne défendons aucune idéologie religieuse ou antireligieuse.
Nous veillons à ce que chaque contenu respecte le droit, l’équilibre et la dignité de tous.
Aucune page du site ne cherche à “convertir” ou à “condamner” : notre but est d’éclairer, non de diriger.
2. Une approche fondée sur la transparence et la rigueur
Nous exposons des contenus issus :
des principales traditions religieuses (islam, christianisme, judaïsme),
des perspectives athées ou laïques sérieusement argumentées,
de faits historiques ou culturels, toujours accompagnés de sources identifiables.
Chaque information vise à répondre à une question réelle que se posent croyants, sceptiques ou curieux — et est présentée sans jugement de valeur.
Notre méthode repose sur trois critères :
Vérifiabilité : toute affirmation peut être documentée.
Lisibilité : le langage est accessible.
Neutralité bienveillante : on peut exposer une conviction sans y adhérer
3. Un projet au service du dialogue et de la cohésion
Dans un pays marqué par la pluralité religieuse, convictionnelle, philosophique, nous croyons que le savoir est un pont.
Plus les citoyens comprennent ce que les autres croient — ou ne croient pas —, moins il y a de peur, de caricature ou de rejet.
L’Unité n’est pas une initiative religieuse.
C’est une plateforme de compréhension mutuelle, où :
Les croyants peuvent lire sans se sentir jugés,
Les non-croyants peuvent comprendre sans se sentir exclus,
Et chacun peut s’enrichir intellectuellement sans se renier.
4. Diversité des perspectives : un choix assumé, conforme à la laïcité
Dans une société pluraliste comme la France, les convictions religieuses, spirituelles et philosophiques sont nombreuses, parfois contradictoires, mais elles coexistent dans le même espace républicain. C’est précisément parce que la laïcité garantit la liberté de conscience que chacun peut croire, ne pas croire, ou changer d’avis — et donc, que chacun peut exprimer et expliquer ce qu’il croit, sans craindre de le faire dans l’ombre ou sous silence.
C’est pourquoi "Les Eternels Apprentis" ont choisi d’exposer les arguments avancés par différents courants de pensée, dans une démarche claire :
Des arguments musulmans (sur l’origine divine du Coran, par exemple),
Des arguments chrétiens (sur le miracle de Fatima, ou les prophéties bibliques),
Des arguments juifs, lorsqu’ils apportent un éclairage sur les textes ou les figures partagées,
Des arguments athées, philosophiques ou scientifiques, souvent fondés sur le doute, la critique ou la construction rationnelle du monde sans Dieu.
L'exploration de la vie de Bouddha, de Zarathoustra, des textes védas Hindous etc.
Cela ne crée pas un mélange confus, mais une carte intellectuelle de ce qui est défendu, pensé, transmis dans l’espace public français — souvent sans jamais être mis côte à côte.
Ce pluralisme affiché n’est pas un relativisme : nous ne disons pas que tout se vaut. Mais nous affirmons que tout ce qui est sincèrement réfléchi, sérieusement argumenté, et respectueusement exprimé mérite d’être compris.
Comme le disait le philosophe Charles Taylor :
“Reconnaître que d’autres que nous peuvent avoir accès à une vérité ne diminue pas la nôtre. Cela l’éclaire.”
Les Eternels Apprentis assument donc ce travail de mise en lumière, de manière structurée, pédagogique et factuelle. Ce n’est pas une concession. C’est une exigence démocratique, un choix d’intelligence collective et de paix civile.
5. L’amalgame entre “parler de religion” et “faire du prosélytisme”
Dans l’imaginaire collectif, évoquer Dieu dans un cadre public revient, pour certains, à “prendre parti” ou “promouvoir une foi”.
Mais ce raccourci est faux — et dangereux. Il revient à dire que :
le fait religieux n’est pas dicible sans engagement,
ou que toute foi exprimée est suspecte.
Ce flou crée un climat d’autocensure :
Des professeurs renoncent à aborder des textes religieux, même lorsqu’ils sont prévus dans les programmes.
Des médias écartent certains sujets par peur de polémiques.
Des initiatives citoyennes évacuent toute référence au spirituel, même quand elle est centrale pour comprendre des réalités sociales.
6. Ce que nous assumons, pleinement
Nous assumons que :
La religion est un fait social, intellectuel, historique majeur. L’ignorer, c’est fausser le débat public.
Le dialogue interconvictionnel demande du courage, car il expose aux incompréhensions.
Respecter la laïcité, ce n’est pas effacer la question de Dieu : c’est en parler sans l’imposer.
C’est pourquoi nous préférons la clarté à l’ambiguïté, l’explication à la caricature, et l’écoute au silence forcé.
III.A.2 Le cas de choisir d'écrire "Muhammad (ﷺ)", dans un cadre laïque
a. Liberté d'expression et laïcité
La laïcité française, fondée sur la loi de 1905, garantit la liberté de conscience et la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Elle n'interdit pas l'expression ou l'étude des convictions religieuses dans l'espace public, tant que cela respecte l'ordre public et les droits d'autrui.
b. L’usage de la formule “Muhammad (ﷺ)” : respect personnel, liberté collective
Dans certains de nos contenus, le nom du dernier Prophète de l’islam est parfois suivi de la formule “ﷺ”, qui signifie « que la paix et les bénédictions soient sur lui » — une invocation de respect traditionnellement employée par les musulmans à chaque mention de son nom.
Ce choix appelle plusieurs précisions :
Il ne s’agit pas d’une obligation religieuse imposée au lecteur, mais d’un marqueur de respect inséré dans des pages qui évoquent des figures spirituelles avec sérieux.
Le rédacteur des Eternels Apprentis est musulman. Bien que la majorité du groupe soit constitué de chrétiens et d'athées, cette mention est une marque de décence et de fidélité à ma foi.
Ma présence dans la rédaction ne transforme pas le projet en initiative religieuse : elle l’enrichit d’une conscience personnelle.Ce geste de respect est parfaitement conforme à la laïcité française, qui ne proscrit aucun mot, aucun nom, aucun vocabulaire culturel ou religieux dans l’espace public ou dans l’expression privée, tant que cela ne trouble pas l’ordre public ou ne vise pas à imposer une croyance.
La liberté d’expression inclut la liberté d’adopter un ton respectueux vis-à-vis de ce que d’autres tiennent pour sacré.C'est une marque de respect profond pour nos concitoyens musulmans.
3. Réponses aux critiques potentielles
Malgré notre respect strict du cadre laïque et notre transparence sur nos intentions, certains nous soupçonneront de bien des maux. Parler de Dieu, de Coran, de miracles, de preuves religieuses ou de figures sacrées déclenche, dans le débat français, une forme de crispation.
Voici les principales critiques que pourrait recevoir L’Unité, et la manière dont nous y répondons — rationnellement et frontalement.
3.a. “C’est du prosélytisme déguisé.”
Ce sera sans doute l’accusation la plus fréquente. « Vous présentez les “preuves” religieuses, donc vous cherchez à convertir. »
C'est principalement faux. L’intention et les dynamique humaines des Eternels Apprentis fait toute la différence.
L’Unité :
n’invite à aucune adhésion,
ne juge aucun lecteur,
ne recommande aucune croyance.
Nous exposons — avec rigueur, sources et nuances — ce que des Traditions (chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste…) les sceptiques ou chercheurs (athées, agnostiques, avancent comme arguments internes. Ce sont des faits culturels, historiques, scripturaires.
Pas des appels à croire.
Ce n’est pas du prosélytisme, c’est de l’analyse comparative.
Comme l’explique le juriste Guy Haarscher :
“Le prosélytisme suppose une pression ou une intention de faire basculer l’autre. L’information libre, même si elle touche à la religion, n’en est pas.”
De plus :
nous présentons aussi les arguments athées,
nous intégrons l’histoire des faits religieux,
nous exposons les points de tension entre les traditions.
Cela prouve que notre but est d’éclairer.
3.b. “C’est une tentative communautariste.”
Deuxième critique : certains pourront affirmer que ce type de projet renforce les identités religieuses, et donc fragmente le lien national.
Ce n’est pas l’identité qui divise, c’est l’ignorance mutuelle.
Ne pas en parler crée des non-dits, des tabous, du soupçon… et donc la crispation.
L’Unité ne renforce pas les “communautés”, elle les met en relation.
Et ce, à égalité :
croyants,
non-croyants,
curieux,
critiques…
Nous voulons des citoyens instruits de ce que l’autre pense, pas des blocs identitaires en silos.
C’est précisément le rôle d’une République laïque éclairée : permettre l’expression de chacun, sans hégémonie.
3.c. “C’est une stratégie déguisée : vous avancez masqués.”
Cette accusation est plus implicite, mais fréquente chez certains polémistes (Éric Zemmour, ou certaines franges radicales de la droite dite “laïque”).
Ils diront :
« Derrière ce langage raisonnable, vous cherchez à réhabiliter la religion dans la sphère publique, à faire avancer l’islam ou à normaliser le religieux comme opinion politique. »
Cette critique repose sur une vision déformée de la laïcité : une forme de laïcisme défensif, qui confond neutralité et exclusion du religieux.
Notre réponse tient en plusieurs points :
Oui, nous parlons de religion.
Oui, nous parlons du Coran, de Jésus, de la foi.
Et nous parlons aussi de critique religieuse, de laïcité, de liberté de conscience, d’athéisme, de science.
Mais nous n’avançons pas masqués (malgré que certains soient grimmés sur notre plateforme live Kick, cela afin de préserver leur vie privée) : nous annonçons très clairement notre but dans notre manifeste.
Nous voulons un site :
factuel,
documenté,
structuré,
sans appel à la foi.
Si certains veulent une société où la seule parole autorisée est celle du silence ou du sarcasme vis-à-vis de la foi, alors oui : nous défendons un autre modèle de laïcité — celui de la connaissance partagée.
Comme l’écrit Régis Debray :
“Laïcité n’est pas hostilité à la religion. C’est l’apprentissage du commun entre des gens différents.”
4. Un appel à l'unité par la connaissance
En rassemblant des informations vérifiables sur les différentes convictions, le collectif "L'Unité" œuvre pour une société éclairée et tolérante. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les valeurs de la République, qui reconnaît et respecte la diversité des opinions et des croyances.
C’est dans cette même logique que s’inscrit toute notre démarche : rassembler sans uniformiser, écouter sans adhérer, exposer sans imposer. En choisissant d’intégrer des signes de respect importants pour certains de nos concitoyens, nous affirmons que l’unité passe aussi par l’attention aux sensibilités de l’autre, dès lors que cela ne nuit à personne. C’est une forme simple, mais forte, de coexistence apaisée.
Nous n’appelons pas à croire. Mais à comprendre.
Et si certains d’entre nous croient, cela reste une affaire personnelle. Ce que nous construisons ici, c’est un espace inclusif, conçu pour tous — croyants, non-croyants, sceptiques, curieux — sans privilège, sans soupçon, sans frontière invisible.
Ce qui divise les sociétés, ce n’est pas tant la diversité des convictions. C’est l’ignorance mutuelle, les soupçons, les projections, les caricatures.
Or, la République laïque ne nous demande pas de tous penser pareil. Elle nous demande d’habiter un même espace commun, en respectant la liberté de chacun.
Et pour cela, il ne suffit pas de tolérer : il faut comprendre.
Comprendre ce que les autres croient — ou refusent de croire.
Comprendre pourquoi cela les structure.
Comprendre ce qu’ils y trouvent, ce qu’ils en espèrent.
Nous ne voulons pas neutraliser les différences.
Nous voulons rendre les désaccords féconds, intelligibles, désarmés de peur.
Même si nous appelions à croire… pourquoi cela resterait légal ?
Nous l’avons dit : nous n’appelons à croire en rien. Et même si certaines personnes dans le collectif ont la foi, cette foi n’est jamais imposée.
Mais à la vérité, il est impossible de prouver nos intentions. Ce que l’on peut juger, ce sont les faits, les mots, les actes.
Et même si nous appelions à croire, ce ne serait pas un crime.
Ce ne serait pas une infraction à la laïcité.
Ce ne serait même pas un manquement à la neutralité, car nous ne sommes pas une institution publique.
La liberté d’expression religieuse est garantie en France par :
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789, art. 10)
“Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses…”
La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État
“La République assure la liberté de conscience.”
La Convention européenne des droits de l’homme (art. 9 et 10)
Ces textes protègent le droit de croire, le droit de dire ce que l’on croit, et même le droit d’espérer que d’autres y croient aussi — tant que cela ne dérive pas en prosélytisme abusif, pression, menace ou discrimination.
Autrement dit :
Un musulman qui explique pourquoi il croit au Coran,
Un chrétien qui parle du miracle de Fatima,
Un athée qui dit que la foi est une construction psychologique,
→ Tous ont le même droit à la parole.
Nos intentions sont invisibles, mais nos règles sont visibles
Dans un espace pluraliste, on ne juge pas les consciences, on évalue les formes.
C’est pourquoi "Les Eternels Apprentis" s’imposent des règles strictes :
Aucune injonction à croire,
Aucune glorification de communauté,
Aucune incitation au mépris de l’autre,
Aucune vérité présentée comme indiscutable.
Ce que nous proposons, ce sont :
des articles vérifiables,
des sources citées,
des raisonnements lisibles,
des réponses ouvertes,
et une forme d’hospitalité intellectuelle pour tous les lecteurs.
La possibilité de modifier nos articles par le débat et le dialogue
Un projet qui propose un chemin
Même si certains pensent que “parler de Dieu, c’est déjà trop”, nous répondons :
Parler, ce n’est pas imposer.
Expliquer, ce n’est pas convaincre.
Exposer des croyances, ce n’est pas les faire avaler de force.
Et quand bien même l’un ou l’autre membre du collectif souhaiterait, au fond de lui, que quelqu’un s’interroge sincèrement sur la foi — est-ce blâmable ?
Ce souhait, s’il existe, reste humain, intime, silencieux.
Ce qui compte, c’est que ce site ne transforme jamais ce désir en pression.
C’est là toute la différence entre un appel libre à la réflexion, et une entreprise de propagande.
Et comme le rappelait le philosophe Henri Peña-Ruiz :
“La laïcité n’interdit pas de dire ‘je crois’. Elle interdit de dire ‘tu dois croire’.”
Unité ne signifie pas uniformité
Nous n’avons pas besoin d’être d’accord sur Dieu, sur les textes, sur la vérité.
Mais nous avons besoin de nous comprendre sans nous exclure.
Cela commence par une idée simple, mais trop souvent abandonnée :
Écouter ce que l’autre croit réellement, et non ce qu’on pense qu’il croit.
C’est pour cela que nous parlons de preuves, d’arguments, de traditions — pas pour convaincre, mais pour donner à chacun les clés du réel.
Conclusion générale : Construire ensemble
Nous avons choisi de parler de religion, dans un pays où cela suscite parfois la gêne, la peur, la colère.
Nous avons choisi de parler aussi d’athéisme, de doutes, de convictions opposées — dans un esprit rigoureux, factuel, sans moquerie ni soumission.
Et nous avons fait tout cela en respectant scrupuleusement la laïcité.
Pas une laïcité de surveillance ou d’exclusion, mais une laïcité mature, ouverte, fidèle à ce qu’elle est fondamentalement :
→ un cadre pour que chacun puisse croire, ne pas croire, débattre, apprendre, sans être réduit à silence ou à violence.
Nous savons que ce projet dérangera certains.
Certains nous trouveront trop prudents. D’autres trop audacieux. D’autres encore trop visibles.
Mais nous ne travaillons ni pour rassurer, ni pour provoquer.
Nous travaillons pour éclairer.
Nous croyons que la République se renforce quand ses citoyens se comprennent, et que la connaissance partagée est un rempart plus fort que les slogans.
Alors nous continuerons.
À écrire, à écouter, à exposer.
À créer un espace où chacun peut lire ce que pense l’autre — non pas pour se rallier, mais pour cesser de fantasmer.
L’Unité commence simplement par le fait de prendre le temps de comprendre.
La question n'est pas de savoir si nous sommes des "laïcards" : nous agissons dans un cadre qui est laïc, par nature. Aucune injonction à croire. Aucune structure religieuse derrière nos contenus. Aucune hiérarchie d’opinions spirituelles ou non spirituelles.
Nous ne donnons pas la parole à une religion, mais à ce que chaque tradition affirme de vérifiable, de documenté, d’intellectuellement formulé. Nous n’appelons à aucune adhésion — mais nous invitons à la compréhension.
Nous ne parlons pas de foi comme certitude imposée, mais comme fait social, culturel, existentiel. Et nous en parlons à égalité avec le doute, la critique, l’athéisme, l’humanisme. Parce que toutes ces voix coexistent dans la République.
Nous sommes dans la légalité la plus stricte :
aucun prosélytisme,
aucune fonction publique ou mission d’État,
aucune atteinte à la neutralité institutionnelle,
et une démarche d’expression pleinement protégée par la liberté de conscience et d’opinion, inscrite dans la Constitution, dans la loi de 1905 et dans la Déclaration des droits de l’homme.
Nous sommes aussi dans la logique la plus profonde de la laïcité : rendre possible le savoir dans la pluralité, sans hiérarchie, sans pression, sans silence forcé.
C’est pourquoi ce que nous faisons ici n’est pas un pas de côté hors de la laïcité — c’est peut-être, sans l’avoir recherché, une de ses expressions les plus équilibrées : celle qui ne dit pas à chacun ce qu’il doit penser, mais lui donne les moyens de comprendre ce que les autres pensent — avec respect, exigence, et lucidité.
les eternels apprentis
Contact
contact@eternels-apprentis.fr
© 2025. Tous droits réservés.
Un média indépendant, pour agir concrètement